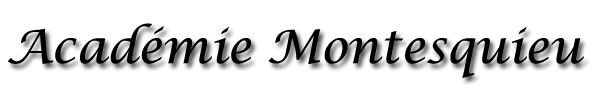Avant de me pencher sur ce sujet, je pensais que le droit de correction marital était un mythe, ou plus exactement une interprétation fantasmée de la réalité médiévale.
Je me trompais : ce droit qui consiste à reconnaître au mari le droit d’infliger des châtiments corporels à sa femme sous prétexte de corriger ses défauts a bel et bien figuré dans l’arsenal juridique de notre pays entre les XIIe et le XVIe siècles.
De nombreux documents littéraires en attestent : contes, fabliaux, chroniques, mais aussi de nombreux documents juridiques : œuvres doctrinales, recueils de coutumes, actes de procédure…
Documents que juristes et ethnologues contemporains ont su exploiter : permettez-moi de ne citer ici que les travaux de Jean-Louis Flandrin et Anne Lefebvre-Teillard auxquels j’ai beaucoup emprunté.
Mais pourquoi s’intéresser aujourd’hui à ce droit depuis longtemps disparu ?
Peut-être, bien sûr, en raison du caractère pittoresque de son intitulé, mais, plus sérieusement, parce que deux raisons le rattachent à notre actualité. La première est que de nos jours, en France, les violences conjugales constituent une triste réalité : une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon et ce dernier a généralement beaucoup de mal à admettre le caractère scandaleux de son comportement. Ailleurs, au Moyen Orient, par exemple, c’est bien pire. Ensuite, et c’est une seconde raison, les principes de laïcité et d’égalité entre hommes et femmes qui fondent notre république me semblent sinon menacés, du moins souvent perdus de vue par certains mouvements politico-religieux. Ceux, par exemple, qui font savoir que ce qui concerne la famille ne regarde pas l’État et affirment que pour leurs membres les règles religieuses priment toujours sur les règles civiles. Ne peut-on craindre alors la résurgence de tribunaux religieux ou communautaires portant atteinte à la compétence des tribunaux publics et au droit des femmes ?
Il n’est pas question pour moi de développer ce thème mais je vous invite à y réfléchir lorsque nous aurons vu comment le droit de correction s’est institué, comment il a été exercé et pourquoi il a disparu.
Les premières mentions – rares – de ce droit, remontent à la fin du XIe siècle mais les coutumiers des siècles suivants montrent qu’il s’est appliqué dans l’ensemble des régions de France, bref, qu’il a été adopté avec enthousiasme par l’ensemble de la population française, masculine tout au moins !
Avant le XIIe siècle, certes, les mœurs étaient rudes et les pères disposaient de droits très étendus sur leur famille ; le mari pouvait même infliger la mort à sa femme s’il la surprenait en flagrant délit d’adultère mais nul ne songeait à évoquer dans ce cas un quelconque droit de correction du mari sur sa femme, ni l’exercice par ce dernier d’une sorte de juridiction domestique. Or, quand ce droit passe en coutume c’est au moment même où les femmes bénéficient d’une situation juridique, économique et sociale particulièrement favorable. Au moment où, également les troubadours célèbrent les mérites de leur dame et chantent les délices de l’amour courtois (qui est un amour adultère !). L’hypothèse la plus vraisemblable me paraît donc être la suivante : le droit de correction émerge au moment où les femmes sont perçues comme trop libres, trop puissantes bref trop dangereuses pour leur mari, pour l’Église, pour la société.
Les études conduites sur la structure des ménages du XIIe siècle semblent confirmer cette analyse puisque l’on constate une forte disparité dans l’âge des époux, disparité qui entraîne nécessairement des attentes différentes de la part de chacun.
On marie les filles jeunes, vers 16 ans, pour qu’elles aient très vite le plus d’enfants possible, à des hommes qui ont en général, le double de leur âge : pour pouvoir se marier les hommes doivent attendre d’être établis, c’est-à-dire confirmés dans leur statut de guerrier, d’artisan ou de chef d’exploitation agricole. Ceci fait d’eux des hommes presque en âge d’être le père de leur femme et bien souvent ils sont tentés de se comporter comme tels. Ensuite, le couple vit au rythme de grossesses répétées et parfois fatales pour la mère. Quand celle-ci survit et que le temps de la maternité s’achève, elle se sent invincible. Elle peut alors être tentée d’inverser les rôles, d’imposer son autorité à un mari vieillissant ou, pire, se laisser séduire par un de ces célibataires non établis qui vivent et travaillent sous leur toit. Certes, l’amour courtois auquel il était fait allusion il y a un instant est un courant poético-philosophique auquel ne peuvent prétendre adhérer que quelques femmes appartenant à l’aristocratie mais l’importance des débats qu’il a suscités révèle l’existence d’une grande libération sexuelle dont les historiens affirment qu’elle a touché toutes les couches de la société et provoque un grand malaise.
L’Église a depuis longtemps pris la mesure du malaise masculin mais ne s’est pas montrée très habile dans la façon de le gérer puisqu’elle a pendant plusieurs siècles littéralement diabolisé la femme en la rendant responsable du péché originel et de la faute d’Adam. Ensuite, vers l’an mil, s’est forgée chez les chrétiens l’idée que la femme ne devient rédemptrice que dans l’absolue pureté : Marie, la « très pure et toujours vierge Marie », l’anti-Ève par excellence, commence alors à faire l’objet d’une dévotion particulière et fervente.
Mais très vite, l’Église et la société civile qui ont découvert les avantages d’une démographie ascendante, s’inquiètent d’un phénomène préoccupant : la prolifération de mouvements hérétiques qui prônent le célibat et l’abstinence sexuelle. Tous s’accordent sur la nécessité d’une clarification doctrinale comme de la remise en ordre de la société ; et c’est dans ce contexte de contradictions généralisées que l’Église, seule autorité morale et politique reconnue, décide de procéder à une grande réforme du mariage. Son but est simple : réhabiliter cette institution et ramener la paix dans les familles.
Pour ce faire, les théologiens du XIIe siècle auraient pu s’inspirer directement du message du Christ rapporté par les évangélistes. Il est simple et clair : le mariage est une bonne et sainte institution au sein de laquelle les époux sont pleinement égaux. Ils ont, de ce fait, les mêmes droits et les mêmes devoirs : cohabitation, assistance et fidélité (en d’autres termes, concernant ce dernier point, l’adultère de l’homme est aussi grave que celui de la femme mais il est aussi, malgré tout, une faute pardonnable dans les deux cas).
Pourtant les théologiens du XIIe siècle vont délibérément « oublier » ce message.
D’abord, parce que comme à leurs prédécesseurs, il paraît peu réaliste dans la mesure où il ne correspond en rien aux traditions des populations juives, romaines puis européennes converties, qui donnent au mari une prééminence totale sur sa femme.
Ensuite, parce qu’il leur paraît dangereux. Si l’on veut faire régner la paix dans les familles il faut que celles-ci, comme l’Église, comme l’Empire, comme le royaume n’aient qu’un chef : le mari.
Alors, pour réformer en profondeur le mariage, ces mêmes théologiens en font un sacrement, mieux, un sacrement que se confèrent les époux eux-mêmes en échangeant leur consentement devant un prêtre.
Désormais, tout ce qui concerne le mariage devenu indissoluble relève du droit de l’Église et de ses tribunaux : les officialités.
Désormais, enfin, la femme est subordonnée à son mari qui brandit contre elle une arme redoutable : le droit de correction dont il convient à présent, dans un second temps, d’examiner les conditions de mise en œuvre.
Les devoirs de l’épouse ont, bien entendu, été clairement définis par les théologiens. Comme l’avaient décidé les Pères de l’Église aux IVe et Ve siècles, un certain nombre d’obligations sont communes au mari et à la femme : devoir conjugal, fidélité et obligation d’assistance. Toutefois, la grande nouveauté est que désormais la femme a envers son mari deux devoirs spécifiques, le respect et l’obéissance, dont les manquements justifieront la mise en œuvre du droit de correction marital : ainsi, est renforcée l’autorité du mari sur sa femme et, simultanément, est soulignée l’infériorité de cette dernière. Notons que fort opportunément l’infériorisation des femmes n’a pas eu pour simple conséquence de mieux les soumettre à leur mari : elle a aussi permis de les écarter des fonctions sacerdotales les plus élevées au sein de l’Église. En somme, le message égalitaire du Christ est réinterprété de la façon suivante : les femmes sont égales aux hommes au plan théologique, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne les rapports avec l’âme, la rédemption ou la sainteté, mais dans tous les autres domaines, la vie conjugale en particulier, elles sont inférieures et doivent être corrigées quand le besoin s’en fait sentir.
Grâce aux recours exercés devant les juridictions ecclésiastiques puis laïques, et grâce aussi aux prescriptions de morale contenues dans certains manuels religieux recensés notamment par Jean-Louis Flandrin, on peut mieux cerner les attentes de la société médiévale pour ce qui concerne le respect et l’obéissance dues par les femmes à leur mari, ainsi que les limites apportées par les autorités au droit de correction exercé par ce dernier .
Pour ce qui concerne le « respect », les textes rédigés en latin utilisent le terme obsequium qui, à Rome, servait à désigner le respect appuyé, presque excessif, de l’esclave envers son maître. Mais au XIIIe siècle, les mœurs sont moins exigeantes : la Très Ancienne Coutume de Bretagne indique que « les femmes doivent craindre et porter révérence et honneur garder à leur mari de la même manière que les enfants le font à leurs parents ou les vassaux à leur seigneur ». Même si elle n’est pas aussi explicite, la coutume de Beauvaisis indique que la femme mérite d’être punie « quand ele desnie son mari » ou « le maudit », c’est-à-dire quand elle contredit publiquement son mari ou dit du mal de lui. On peut noter qu’ici la coutume n’exprime pas une obligation générale de respect mais précise le domaine dans lequel celui-ci doit spécialement s’exercer : le domaine social immédiat constitué par le cercle familial et le voisinage.
Concernant l’obéissance, le Très Ancien Coutumier Normand déclare que « la femmes doit obéir au mari dans beaucoup de choses et presque dans toutes ». Faut-il comprendre qu’en Normandie, la femme est condamnée à un devoir d’obéissance quasi-absolu ? Très certainement… Ailleurs, en Beauvaisis, il semblerait limité à certaines solutions ; mais quand la coutume affirme que ce droit doit jouer « quand elle ne veut obéir aux resonables commandements de son mari », on comprend que ce dernier pourra pratiquer son droit de correction dès que bon lui semblera.
Cette obéissance a tout de même des limites. La femme ne doit pas obéir à son mari s’il lui ordonne de se livrer à des actes contraires à la religion ou aux bonnes mœurs : se prostituer, par exemple (« Quant ele a mari qui la veut fere pecher de son corps ne pas louer ne en autre manière »).
En sens inverse, pour certains auteurs, ce droit de correction peut être étendu à d’autres domaines que l’obéissance et le respect, le devoir de cohabitation en particulier. Certes, il s’agit là d’une obligation commune aux deux époux, mais qui pèse plus lourdement sur la femme en cas de mauvais traitements ; Beaumanoir, par exemple, exige qu’elle soit contrainte de cohabiter avec son époux même si elle refuse de le faire au prétexte qu’il la brutalise. Car, écrit le rédacteur des coutumes de Beauvaisis, « il est normal qu’elle ait à souffrir et endurer avant qu’elle se mette hors de la compagnie de son mari ».
A contrario, la coutume de Beauvaisis admet que dans certains cas, elle est en droit d’abandonner le domicile conjugal. En particulier, quand son mari se contente de lui donner à boire sans lui fournir aussi de quoi se nourrir et se vêtir, ou lorsqu’il entretient une autre femme dans sa maison au vu et au su des voisins. Mais de toute façon, le mari retrouve son droit de correction plein et entier lorsqu’il « estime » que sa femme est « en voie de fere folie de son corps ». On imagine que ses « estimations » dépendront de sa seule compétence.
Ainsi, ce droit existe bel et bien au Moyen Age et il est parfaitement accepté par le corps social. Au point que si un mari ne se montre pas assez sévère avec sa femme et surtout s’il se laisse battre par elle, sa famille et son voisinage viennent le rappeler à ses devoirs en organisant un charivari ou une « asnade » pour le ridiculiser. Flandrin rapporte même qu’en Gascogne, l’âne devait être tenu en laisse par le plus proche voisin du mari et que si ce dernier refusait cet « honneur – ou cette corvée – il était soumis à une amende de dix livres que percevait la foule ameutée ».
Peut-on en déduire que si ce droit est tellement bien accepté par le corps social c’est parce qu’il s’exerce dans la modération ? bien au contraire, semble-t-il, car la réalité que laissent entrevoir les coutumiers est terrifiante.
En normandie, la « Summa de Legibus Normaniae » permettait à un homme de donner à sa femme autant de coups qu’il le jugeait bon car on présumait qu’il restait dans les limites de son droit de correction. Au XVIIIe siècle, un jurisconsulte normand, manifestement nostalgique, assurait « qu’autrefois » les femmes de cette province avaient interdiction de couper leurs cheveux afin que leur mari puisse les traîner plus commodément. Finalement, l’essentiel était qu’il n’y eut pas de blessure trop apparente car la femme était habilitée à agir pour excès contre son mari lorsque celui-ci lui avait arraché un œil, cassé un bras ou l’avait frappée de coups « énormes, fréquemment et sans motifs valables ».
La position des juristes de Beauvaisis est sensiblement la même, le mari peut battre sa femme pourvu que cela s’effectue « sans mort et sans mehaing », c’est-à-dire sans entraîner la mort et sans épanchement de sang.
Les coutumes du nord interdisent la mort mais ne s’offusquent pas de pratiques extrêmement cruelles puisque dans la province du Limbourg, dans l’actuelle Belgique, le mari a le droit de « taillader (sa femme), de la pendre de haut en bas et de se chauffer les pieds dans son sang, à condition de la recoudre et pourvu qu’elle reste en vie ».
N’imaginons pas que les traditions méridionales sont plus clémentes. La coutume de Bergerac, rédigée en 1387, permet au mari de battre sa femme jusqu’à effusion de sang pourvu que ce soit « bono zelo » (avec l’intention de la corriger). Celle de la vallée de Barèges, en 1404, précise que « tout maître et chef de la maison peut châtier femme et famille sans que nul ne puisse y mettre obstacle ». Mais encore faut-il que le « chef de maison » soit un homme car dans cette vallée pyrénéenne le droit d’aînesse joue même en faveur des femmes et ce sont les héritières qui gouvernent leur mari et leurs frères cadets sans pour autant pouvoir prétendre le scorriger. En revanche, si l’héritier est un homme, le droit de correction s’applique comme ailleurs à la discrétion du mari. Seule restriction apparente, dans le Béarn voisin, la coutume précise que si les coups portés par le mari à la femme enceinte entraînent la mort de celle-ci, il y a « homicide ». Doit-on comprendre que si la femme n’est pas enceinte et qu’elle meurt sous les coups du mari, on reste dans le cadre de l’exercice normal du droit de correction ?
À Bordeaux, en 1359, la coutume déclarait qu’un mari ayant tué sa femme dans un accès de colère, n’encourait aucune peine si, par un serment solennel, il s’en confessait repentant.
Finalement, ni le droit canon, ni les coutumes qui s’accordent à reconnaître que le droit de correction ne doit pas dépasser certaines limites, ne donnent de références claires sur ce qui est permis ou interdit et de toute façon tolèrent un degré de violence très élevé. Ainsi, les maris brutaux ne risquent-ils pas grand-chose et ils le savent bien.
Que se passe-t-il en effet, si une femme se plaint des « corrections » excessives de son mari ? Dans un premier temps, les juges ecclésiastiques ou laïcs essayent de réconcilier les époux. Ils interviennent auprès des membres de la famille proche, s’adressent au mari pour lui demander de ne plus maltraiter sa femme, du moins pas au-delà du cadre normal du droit de correction et simultanément chapitrent la femme pour qu’elle renonce à ses griefs. Au pire, l’official menace le mari d’excommunication et de peines pécuniaires en cas de récidive. Mais, on sait bien qu’en ce domaine, il y a toujours récidive et aggravation des violences aussi. La femme qui craint pour sa vie doit obtenir le droit de se protéger efficacement.
Au XIIe siècle, elle ne pouvait se tourner que devant les juridictions ecclésiastiques mais trois siècles plus tard, elle dispose d’une autre solution : porter sa cause devant les juridictions royales dont l’autorité s’affirme et qui ne demandent qu’à gagner la confiance des justiciables. Ce sont ces dernières qui emporteront l’avantage avant que le droit de correction marital ne soit finalement anéanti par le roi.
Sacrement représentant l’union du Christ et de l’Église, le mariage unit de façon indissoluble les époux pour tout le restant de leur vie. Pas question, par conséquent, au moment où l’Église a enfin réussi à imposer sa législation et sa juridiction à des foules mécréantes, c’est-à-dire aux XIe-XIIe siècles, de permettre à une femme maltraitée de demander le divorce. Car les enjeux sont importants. Aux yeux des clercs, les effets du mariage sont doubles : comme tous les sacrements, il est « dispensateur de grâces » pour les époux mais il a, en outre, un intérêt social : il sert de « remède à la concupiscence » en canalisant les ardeurs des conjoints et enfin, il assure la perpétuité du groupe. En un temps où l’on prend conscience de l’importance de la démographie, il est difficile d’encourager l’abstinence en permettant aux époux de se séparer même temporairement. Par ailleurs, les clercs savent bien que le devoir de fidélité dû par chacun des époux à son conjoint sera difficile à respecter si les époux ne cohabitent plus.
Pendant longtemps, les juridictions ecclésiastiques ont donc refusé aux femmes victimes de maris violents mais qui ne mettaient pas leur vie en danger de façon évidente, le droit de se séparer d’eux. Toutefois, lorsqu’elles pouvaient prouver qu’elles étaient en danger de mort, l’Église leur accordait, à défaut de divorce qui implique rupture définitive du lien conjugal, la séparatio corporalis ou le divorcium quoad thorum et mensam qui s’en rapproche beaucoup. Dans ce cas, les époux étaient en effet autorisés à vivre séparément mais restaient tenus au devoir de fidélité ainsi qu’à une certaine assistance mutuelle qui se traduisait ordinairement par le versement d’une pension alimentaire à la femme, le mari restant en possession des biens du ménage. Cette solution, difficile à organiser, ne pouvait être appliquée qu’aux cas les plus graves ; elle devait rester exceptionnelle et en principe provisoire, même si l’on savait qu’en pratique elle serait appelée à durer.
Mais quelle solution adopter pour les femmes victimes de ces violences ordinaires ou répétées qui rendent la vie commune insupportable sans pour autant les mettre en danger de mort ? Dans son étude consacrée aux officialités à la veille du Concile de Trente, Anne Lefebvre-Teillard observe que la jurisprudence de ces juridictions répond à la mésentente des époux de trois façons différentes. Certains juges, comme à Cambrai, acceptent par compassion d’étendre la séparation de corps à des causes non prévues par le droit canonique. D’autres, comme à Montivilliers, restent très restrictifs dans l’application des mêmes textes. Mais dans la grande majorité des cas, l’official adopte une solution de compromis qui met fin à une vie commune intolérable tout en sauvegardant les principes du droit canon par le maintien du devoir conjugal : c’est la séparation thori reservato ou séparation d’habitation pour cause d’austeritas. En d’autres termes, les époux sont autorisés à vivre séparément mais à condition de respecter le devoir conjugal !
On peut imaginer toutes les tracasseries et les inquiétudes que pouvait susciter l’exécution d’une telle obligation et c’est pour cela, vraisemblablement, que les historiens du droit ont longtemps présumé que dans la plupart des cas le maintien du devoir conjugal entre les époux restait théorique. Cependant, l’étude d’Anne Lefebvre-Teillard montre qu’il n’en était rien : à Troyes, l’official faisait prêter aux époux le serment de se rendre le debitum conjugale et l’auteur a pu relever dans les registres étudiés dans le cadre de sa recherche, plusieurs cas d’actions de requête portant sur ce point. Comment expliquer alors que les femmes désireuses d’obtenir une séparation pure et simple de leur violent conjoint n’aient pas songé à porter leur requête devant un juge laïc, qui, depuis le XIIIe siècle, n’hésitait pas à octroyer à l’épouse séparée une provision sur les biens communs ? Tout simplement parce que la séparation des époux, qui met en cause l’indissolubilité du mariage relève de la compétence exclusive des Tribunaux ecclésiastiques et que même les juges laïcs jugent ce point indiscutable. Il faudra attendre les premières décennies du XVIe siècle pour qu’à l’occasion du prononcé d’une séparation de biens, le juge laïc ordonne accessoirement une séparation d’habitation.
Mais, de toute façon, les progrès de l’autorité royale sont tels qu’à partir du XVe siècle, par le jeu de l’appel, même les officialités se trouvaient soumises au contrôle du Parlement. Désormais, le roi et ses agents sont redevenus les gardiens naturels et bientôt exclusifs de l’ordre social.
Le roi ne s’est pas contenté d’encadrer le droit de correction : il l’a, de fait, aboli. Dans l’ordonnance de Blois de 1579, qui régit désormais le droit du mariage en France, on ne trouve pas la moindre allusion à ce droit légendaire. Et cependant, l’idée que le mari, chef de la cellule familiale, a autorité sur sa femme y est plus que jamais affirmée. Mais la différence essentielle avec l’ancienne tradition est que désormais le mari ne peut plus sanctionner lui-même les défaillances de sa femme sous prétexte de les corriger. Désormais, celui-ci devra soit s’adresser à un tribunal royal (au risque de porter atteinte à l’honneur familial en portant à la connaissance des tiers, par une procédure contradictoire, des faits humiliants) soit préférer utiliser une procédure nouvelle, administrative et totalement discrète, en demandant au roi une lettre de cachet. Si cette seconde voie est choisie, l’intendant, après une enquête rapide fera enfermer l’épouse coupable dans un établissement clos, forteresse ou couvent, où elle devra demeurer aussi longtemps qu’elle n’acceptera pas de modifier son comportement fautif.
Bien des auteurs de la fin du XVIIIe siècle ont vu dans cette procédure éminemment critiquable, bien entendu, la continuation du droit de correction. Cependant, même si les garanties procédurales offertes à l’accusée étaient faibles, elles existaient quand même, la privation de liberté n’était accompagnée d’aucuns sévices et surtout la décision portait le sceau de l’autorité souveraine, non de l’arbitraire marital.
Il faut ajouter enfin que ces lettres de cachet n’étaient pas nécessairement réclamées au roi par les maris désireux de punir leur femme. C’était parfois la victime elle-même qui, pour échapper aux « corrections » de son mari, demandait au roi son propre enfermement. Bien entendu, les conditions de détention variaient considérablement selon les lieux et surtout la fortune des détenues qui devaient acquitter le prix de leur internement, mais beaucoup préféraient renoncer à leur liberté plutôt que de continuer à subir les violences de leur mari.
En abolissant les lettres de cachet, en instituant le divorce, les hommes de la Révolution ont entamé un combat, qui n’est pas encore achevé, en faveur de l’égalité des époux et contre les violences conjugales. Il faut espérer que l’obligation de respect – réciproque désormais – entre les époux, introduite par la loi du 4 avril 2006 dans l’article 212 du Code Civil y contribuera au moins un petit peu.