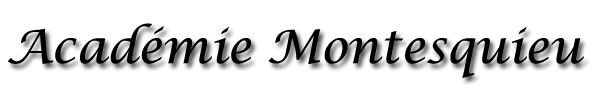Qui ne se souvient de Georges Brassens évoquant Montaigne et La Boétie dans une chanson dédiée à ses copains ? Qui n’a pas eu l’occasion de lire ou d’entendre cette formule, quasi sacrée, de leur amitié : « En l’amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l’une en l’autre, d’un mélange si universel, qu’elles effacent, et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en répondant : Parce que c’était lui, parce que c’était moi. Il y a au-delà de tout mon discours, et de ce que j’en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union » (livre I, 27, p.291). Le chapitre De l’Amitié, voué à La Boétie, est situé au centre du premier livre des Essais parus en 1580 chez Simon Millanges, imprimeur-libraire de Bordeaux. Il est suivi d’un chapitre dédié à Madame de Gramont, épouse du comte de Gramont, proche du roi Henri III et « ami » de Michel de Montaigne. À cette grande dame qui se fait appeler Corisande, héroïne du roman en vogue de l‘Amadis des Gaules, sont offerts vingt-neuf sonnets « amoureux » d’Étienne de La Boétie. Encore présents dans l’édition parisienne des trois livres des Essais de 1588, les voilà condamnés sur l’Exemplaire de Bordeaux, destiné à préparer une nouvelle édition : Montaigne les a tous barrés de deux grands traits de plume obliques avec la mention suivante : « Ces vingt neuf sonnets d’Estienne de La Boëtie qui estoient mis en ce lieu ont esté despuis imprimés avec ses œuvres ». Aucune publication ultérieure n’est venue vérifier son constat. Et les futures éditions des Essais font état de ce « vide » au cœur du Livre 1.
Quand Montaigne disparaît à son tour, le 13 septembre 1592, voilà près de trente ans que son ami n’est plus de ce monde. Son décès, le 18 août 1563, a eu lieu au domicile de la sœur et du beau-frère de Montaigne, les Lestonnac, dans leur demeure de Germignan, paroisse du Taillan. Ce n’était qu’une halte conseillée par Montaigne à son ami pour s’y reposer et calmer d’intenses maux de ventre survenus le 9 août en fin de journée après avoir disputé une partie de jeu de paume. La Boétie est accompagné de son oncle Étienne et de Marguerite de Carle, son épouse depuis 1554. Pour elle, cette union fut un remariage en tant que veuve du chevalier d’Arsac. Mère de deux enfants, elle se rend souvent dans leur domaine d’Arsac en Médoc, devenu un lieu privilégié d’inspiration pour son second mari de dix à quinze ans plus jeune qu’elle. Le récit de l’agonie de La Boétie est contenu dans une longue lettre adressée par Montaigne à son père, Pierre Eyquem, afin qu’il veuille bien accueillir cet ami, devenu un frère, au sein de leur familia. Quant à lui, après avoir fait le décompte exact de la durée de la vie de son ami (32 ans, 9 mois et 17 jours), il est Seul, pour toujours. Une mission primordiale lui revient : rassembler les écrits épars de La Boétie, autant de « reliques » à ses yeux. Cette tâche demande du temps et des moments de liberté alors que se poursuivent ses fonctions de conseiller du roi au parlement de Bordeaux, créé par Louis XI en 1462.
Une fois promu seigneur de Montaigne à la mort de son père en 1568, il fait publier à Paris en novembre 1570, chez Fédéric Morel, les écrits de son ami. Pour la première fois, leurs noms sont réunis dans ces Œuvres qui font la part belle à La Boétie avec ses traductions de Plutarque et Xénophon, avec ses poèmes latins (Poemata) et ses Vers françois ; seules deux pièces portent le nom de Montaigne : la lettre à son père sur la mort de La Boétie et une épître de consolation, empruntée à Plutarque et adressée à son épouse, Françoise de La Chassaigne, après la mort de la petite Toinette, leur premier enfant, née en juin 1570 et décédée deux mois plus tard. Pour la première fois, en dédicaçant chacune des pièces à de grands personnages du royaume, Montaigne déplore leur ingratitude envers son ami dont le talent incomparable aurait fait merveille « au gouvernement des affaires du monde » pendant que sa carrière restait prisonnière des « cendres casanières ». Malgré tout, il lui plait de proclamer que son ami fut heureux : » jamais homme n’a vécu plus satisfait, ni plus content ».
À cette occasion et pour la première fois, il dévoile dans un « avertissement au lecteur » son choix de ne pas publier dans les Œuvres de son ami : un Discours de la servitude volontaire et quelques Mémoires de nos troubles sur l’Édit de Janvier 1562. Il en donne la raison suivante : « Mais quant à ces deux dernières pièces, je leur trouve la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d’une si mal plaisante saison ». Pour la première fois, Montaigne fait précéder du mot Discours le titre d’un manuscrit qu’il attribue nommément à son ami malgré la « mal plaisante saison » des guerres de religion et de leurs infinies violences et souffrances. Pourquoi ce refus de Montaigne alors que des versions recopiées du manuscrit de la Servitude volontaire circulent parmi les conseillers des parlements de Bordeaux et de Paris ? Est-ce pour le réserver à son usage personnel lorsque il commencera la rédaction des Essais, un monument dédié à l’ami disparu ? En tout cas, le chapitre de l’Amitié, rédigé vers 1572-1573, ne se lit et ne se comprend qu’en référence au Discours à l’origine de leur rencontre, sans doute en 1557.
Ces deux Périgourdins, issus de familles bourgeoises sur le pas de la porte de la noblesse d’offices, auraient dû se rencontrer plus tôt. Notamment au collège de Guyenne, créé à Bordeaux en 1533. Mais Étienne de La Boétie, né à Sarlat en 1530 et précocement orphelin, ne fréquente pas ce collège pour des raisons religieuses. Son oncle et tuteur, prêtre du diocèse de Sarlat, redoutant pour lui « la contagion des idées réformées » diffusées dans les années 1540 par les régents du collège bordelais qui seront les maîtres du jeune Montaigne. De son côté, La Boétie a vécu dans Sarlat la période bénéfique de l’installation d’un évêque venu de Florence, le fastueux et érudit Nicolas Gaddi, grand collectionneur de manuscrits, proche de la Curie et des Médicis. Il ne fait qu’une courte apparition dans son diocèse qu’il laisse aux mains des lettrés de son entourage. Grâce à eux, au sortir de l’enfance La Boétie entre de plain pied à l’école des connaissances de la Renaissance et de l’étude approfondie des auteurs grecs et latins au point de devenir un helléniste hors pair, admiré de ses collègues pour ses qualités de traducteur et la correction de leurs fautes. Afin ne pas se comparer à lui, Montaigne s’est fait moins helléniste qu’il n’était. Enfin tous deux, parfaits latinistes, ont fait le choix d’écrire en français pour rehausser et célébrer la langue de leur patrie.
On ignore à quel âge La Boétie est entré dans un collège parisien. Son séjour dans la capitale lui a permis de fréquenter les futurs poètes de La Pléiade. En 1549, leur groupe se constitue sous le nom de Brigade avec Ronsard, du Bellay, Baïf, Jodelle et Pontus de Tyard. Ses études se terminent dans la célèbre université des Lois d’Orléans où se trouve le registre, daté du 23 septembre 1553, qui porte mention de l’obtention de sa licence et des droits qu’il doit acquitter. En octobre de la même année, il est autorisé à acheter la charge de conseiller au parlement de Bordeaux rendue vacante par Guillaume de Lur-Longa, lui aussi périgourdin, parti siéger au parlement de Paris. Au printemps suivant, le 17 mai 1554, La Boétie est reçu conseiller grâce à une dispense d’âge, pratique habituelle en ce temps. Deux mois plus tard, Pierre Eyquem, le père de Montaigne, est élu maire de Bordeaux par ses six collègues de la Jurade avec l’assentiment du roi. La Boétie n’a pas oublié cette concordance de leurs nominations dans l’un de ses poèmes latins.
« Nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche, que l’un à l’autre » (Essais, I, 27, p.291)
À 24 ans, Il vient d’entrer par la grande porte au parlement de Bordeaux accueillant aux Périgourdins qui, de génération en génération, reçoivent le bénéfice de leur fidélité au roi de France, avant la fin de la guerre de Cent Ans. Et il vient d’offrir en hommage à Guillaume de Lur-Longa son manuscrit de la Servitude volontaire : texte bref, incisif, conçu comme un hymne à une liberté perdue par la faute des humains qui se sont mis en servitude à force de soumission à l’égard de tyrans qui les ont abêtis : » les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres telles drogueries c’étaient aux peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de la liberté, les outils de la tyrannie ». Il faut lire à haute voix cette démonstration implacable, ponctuée de deux dédicaces à Guillaume de Lur-Longa qui datent de 1553 la rédaction finale du Discours.
Il est très tôt et très vite diffusé parmi les conseillers. Les uns se sentant investis de la mission de devenir ces gens « bien nés » que La Boétie sollicite ardemment pour éveiller chez leurs contemporains le souvenir de leur liberté perdue. Les autres souhaitant réfuter une démonstration qui dénonce la monarchie, ses courtisans et ses ministres, jugés comme tyranneaux. La Boétie est allé plus loin encore en malmenant les insignes de la royauté : « …Les nôtres semèrent en France je ne sais quoi de tel, des crapauds, des fleurs de lys, l’ampoule et l’oriflamme ». Suprême audace qui s’en prend à la cérémonie du sacre avant d’opérer, un peu plus loin, un repli stratégique en forme de louange aux rois de France « choisis par le dieu tout puissant ». Montaigne a voulu connaître l’auteur de la Servitude volontaire, et leur rencontre en 1557-1558 fut à la fois banale, « lors d’une grande fête et compagnie de ville », et scellée pour l’éternité. Comment résister à cette « ordonnance du ciel » invoquée dans le chapitre de l’Amitié ! Et comment, pour Montaigne, ne pas reconnaître la supériorité d’un tel ami : » j’étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout, qu’il me semble n’être plus qu’à demi » (I, 27, 299) ?
Voilà pourquoi le Discours fait corps avec le chapitre de l’Amitié. Or, il est absent de toutes les éditions des Essais sans que jamais soit modifié, au sein du chapitre, le cadre qui devait l’accueillir. À nouveau, comme en 1570, Montaigne explique les raisons de cette absence : « C’est un discours auquel (La Boétie) il donna nom : La Servitude volontaire : mais ceux qui l’ont ignoré, l’ont bien proprement depuis rebaptisé, le Contre-un (tyran). Il l’écrivit par manière d’essai, en sa première jeunesse, à l’honneur de la liberté contre les tyrans »( I, 27, 283). Il dit vrai puisque le Discours a fait l’objet d’une « récupération » par les protestants aux lendemains des massacres de la Saint-Barthélemy de l’été 1572. Pour eux, c’est au sommet de la monarchie que s’est ourdie la conjuration contre les chefs du parti protestant présents dans la capitale au mariage de la princesse catholique Marguerite de Valois avec le prince protestant Henri de Navarre. Ainsi l’ont voulu les négociateurs de la paix de Saint-Germain de 1570 afin de réconcilier les sujets du roi. L’ampleur et l’horreur des massacres à Paris puis en province mobilisent l’Europe protestante contre un clan de tyrans : Catherine de Médicis et ses deux fils, Charles IX et le duc d’Anjou. La Servitude volontaire est devenue une arme de combat. C’est pourquoi, condamné par le parlement de Bordeaux, le Discours est livré aux flammes en 1579, juste avant la première édition des Essais. Son long parcours clandestin commence. Il dure en France jusqu’en 1727, année de sa première parution officielle, en annexe aux Essais.
Dès lors, Montaigne s’en tient à une version scolaire de la Servitude volontaire et, pour mieux prouver que cet écrit est l’œuvre d’un « garçon » dont la précocité est inséparable de l’innocence, il le rajeunit de deux ans dans les ajouts de l’Exemplaire de Bordeaux : c’est à 16 et non à 18 ans que son ami a composé le Discours. Une raison historique motive ce rajeunissement. À la fin de sa vie, Montaigne rejette la version selon laquelle La Boétie aurait été inspiré, à 18 ans, par une révolte qui a tant choqué leurs contemporains : le soulèvement des Bordelais en août 1548 contre l’instauration de la gabelle, cet impôt tellement impopulaire prélevé sur la consommation du sel. Aux journées sanglantes de la rébellion marquée par le massacre du représentant du roi, Tristan de Moneins, auquel assiste épouvanté le jeune Montaigne, aurait suivi dans la ville une étrange période de calme, faite d’une totale résignation et d’un accablement annonciateurs d’une obéissance sans condition. La répression du roi Henri II fut à la mesure de cette soumission, gage d’un pardon rapide qui scelle la perte des libertés d’une ville rentrée dans le rang. En 1545, le Périgord avait connu pareille tourmente et vécu un brutal retour à l’ordre capables de nourrir la réflexion d’un génial « garçon » de 15 ans.
La parole est à Étienne de La Boétie : « Nous sçavons après tout les malheurs de notre âge » (sonnet XXIV)
Comment La Boétie a-t-il vécu son amitié avec Montaigne ? La réédition récente de ses Poésies complètes éclaire des aspects passés sous silence ou rarement évoqués. Trois de ses poèmes latins sont dédiés à Michel de Montaigne et l’un d’eux, riche de 322 vers, se transforme en une leçon de morale sur les désordres amoureux de Montaigne, le célibataire, en proie à des tentations qui n’échappent pas à son entourage : « nous tes amis, nous te savons / Également prêt à la connaissance des vices comme des vertus… ». Ce conseil d’Ami scelle leur entente comme le révèle Montaigne dans le chapitre de l’Amitié : « Il (La Boétie) écrivit une Satire Latine excellente, qui est publiée (en 1571) : par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à la perfection »(p.291). Cette effervescence d’une poésie ludique révèle à quel point La Boétie est intégré au sein du parlement et de ses cercles humanistes. La conjugaison de son talent et la renommée littéraire et scientifique de la famille des Carle, celle de son épouse, font merveille auprès de ses correspondants dont certains sont célèbres : le cardinal Charles de Lorraine, Jules-César Scaliger et son fils Joseph, sans oublier les hommages funéraires à de grands personnages, tel François de Guise, mortellement blessé en février 1563.
Maints loisirs rapprochent La Boétie de ses collègues avec une prédilection pour le jeu de paume dont les salles sont nombreuses dans Bordeaux et l’on sait que les premiers symptômes du mal qui l’emporte sont apparus à la fin d’une partie disputée en pleine chaleur. Plus calmement, ces conseillers partagent l’attrait du théâtre pour avoir été, dans leurs collèges, acteurs de tragédies et de comédies en latin et, parfois, de farces en français à destination d’un large public. La Boétie, censeur occasionnel des pièces représentées au collège de Guyenne, le rappelle plaisamment dans sa leçon de morale à Montaigne. La plupart d’entre eux habitent des hôtels (oustaus) au cœur de la cité, à proximité de l’hôtel de ville et du palais de l’Ombrière où siège le parlement. Ils sont héritiers ou acquéreurs de seigneuries hors de la ville, plantées de vignes et de céréales, avec potagers et vergers. Le temps n’est pas encore venu de la monoculture des vignobles. Leurs sessions au parlement sont entrecoupées de « vacances » dans leurs maisons des champs : des « bourdieux », implantés au Moyen-Âge et transformés en « châteaux » à l’âge d’or du commerce des vins de Bordeaux : le XVIIIe siècle. Dans leurs domaines de « vacances », ils chantent la nature et la vie en liberté, loin des villes et de la Cour : comment ne pas répondre à l’invitation amoureuse de l’un des plus beaux sonnets de La Boétie dédié aux paysages du Médoc que Marguerite lui a fait découvrir ?
Mais la tonalité assombrie des deux tercets conduit au dernier vers qui est un cri du cœur : « Nous sçavons après tout les malheurs de notre âge ». Ainsi se résume la malchance de la génération de La Boétie et de Montaigne entrée au parlement sous le règne de Henri II et devenue responsable d’un cheminement judiciaire qui mène à la condamnation et, parfois, à la mort sur le bûcher des coupables d’hérésie. Mission éprouvante et douloureuse que La Boétie partage avec ses collègues de la chambre des enquêtes, avant de transmettre aux membres de la grande chambre le jugement des « mal sentans de la foi ». En 1561 et 1562, il s’est consacré au rétablissement de la paix civile afin de réconcilier catholiques et protestants. Telle était la volonté du chancelier Michel de L’Hôpital que La Boétie a rencontré à Paris avant de partir en mission en Bazadais et en Agenais pour mettre fin aux violences religieuses. Aux côtés d’un homme de guerre, le sieur de Burie, il est le premier rédacteur d’un édit de pacification dont les clauses serviront aux édits ultérieurs qui mènent à l’Édit de Nantes de 1598. Ni lui, ni Montaigne ne pouvaient imaginer pareil aboutissement après tant d’échecs et de souffrances qui ont accompagné les quelques années de leur amitié.
Elle faisait partie d’un programme de « bonne vie » que La Boétie a résumé à la fin de son Discours : « c’est un nom sacré, c’est une chose sainte ; elle ne se met jamais qu’entre gens de bien, et ne se prend que par une mutuelle estime ; elle s’entretient non tant par bienfaits que par la bonne vie ; ce qui rend un ami assuré de l’autre, c’est la connaissance qu’il a de son intégrité (…). Il ne peut avoir d’amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l’injustice « (p. 124). Montaigne lui a répondu dans le chapitre de l’Amitié.
Conclusion : L’ultime déclaration d’amour/amitié de Montaigne à La Boétie.
Là voici insérée dans le texte dont elle constitue une conclusion en forme de constat : « Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu’accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s’entretiennent. En l’amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l’une en l’autre, d’un mélange si universel, qu’elles effacent, et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en répondant : Parce que c’était lui, parce que c’était moi. » Tel est, dans cette dernière phrase, l’enchaînement des deux propositions causales—exprimées en termes grammaticaux—qui scellent à jamais l’amitié de Montaigne et de La Boétie. Il faut la lire d’un trait pour saisir sa beauté singulière, solennelle et tellement personnelle. Il nous semble même pouvoir suivre des yeux le trajet de la plume de Montaigne, traçant sur le champ et en totalité cette phrase inspirée, dotée d’une résonance parfaite que l’emploi de l’imparfait rend plus émouvante encore : « …pourquoi je l’aimais ». En effet, La Boétie est mort depuis des années lorsque Montaigne entreprend l’écriture des Essais, seule la longue lettre écrite à son père sur l’agonie de son ami a servi de prélude aux hommages qu’il entend lui rendre, à commencer en 1570 par l’édition chez un éditeur parisien, Fédéric Morel; des « reliques » dispersées de l’œuvre inachevée de son ami disparu.
Or, l’observation de l’un des ajouts de l’exemplaire de Bordeaux révèle un tout autre cheminement d’écriture qui mérite bien l’appellation d’aventure que lui donne Madeleine Fragonard. Cette « aventure » se déroule dans le temps long de la composition des Essais que Montaigne débute dans les années 1572-1573 et qu’il mène jusqu’à sa mort survenue en septembre 1592. Dans la première édition des deux premiers livres, confiée en 1580 au libraire-imprimeur Simon Millanges, la phrase se termine par un constat simple et brutal, apparemment définitif : « cela ne se peut exprimer ». Dans ce constat, fait quelque trente ans après la mort de La Boétie, en août 1563, Montaigne signifie à son lecteur qu’il ne saurait aller plus loin pour répondre à une question venue de l’extérieur sans qu’il ait eu, lui-même, l’audace ou l’inconvenance de se la poser : « si l’on me presse de dire pourquoi je l’aimais ». En 1588, lorsque paraît chez Abel Langelier, un libraire-imprimeur parisien, une nouvelle édition comprenant les trois livres des Essais, cette interrogation est toujours sans réponse. Les huit années qui séparent l’édition bordelaise et l’édition parisienne n’ont pas permis à Montaigne d’aller plus avant dans l’explication de l’amitié indicible qui le lie à La Boétie. C’est seulement dans les ajouts préparatoires à une nouvelle édition que Montaigne de retour chez lui, à partir de l’automne 1588, rédige un complément à sa phrase. Il le fait en deux fois comme le signale l’emploi de deux encres différentes. La première, écrite avec une encre plus foncée et moins délayée, lui dicte une proposition causale directement rattachée au verbe « exprimer » qui termine sa phrase : «..ne se peut exprimer qu’en répondant parce que c’était lui. »
Ce prolongement oblige Montaigne à modifier la ponctuation : le point placé après le verbe exprimer est supprimé et, désormais, ce sont deux points qui figurent après « répondant » et qui restent en suspens à la suite de « lui ». Pendant un temps dont la durée reste inconnue, ils n’accueillent aucune suite. Puis, ils servent à introduire la dernière partie de la phrase, enfin aboutie quelques vingt ans plus tard : « parce ce que c’était moi ». Curieusement, l’encre plus épaisse et moins nette de ce dernier ajout n’a pas permis à Montaigne de tracer un point aussi net que les précédents. Il s’apparente plutôt à une virgule…Quoi qu’il en soit, Montaigne a tenu à insérer correctement cet ajout en deux temps dans la nouvelle rédaction de son chapitre comme le prouve le tracé manuscrit de la majuscule qui introduit la phrase suivante : « Il y a au-delà de tout mon discours, et de ce que j’en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. »