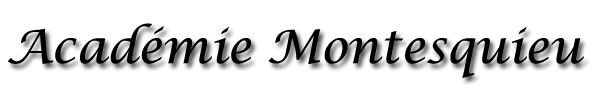Le MONTESQUIANA de Pierre BERNADAU
Michel Colle
Ce texte est la transcription du manuscrit appartenant aux Oeuvres Héréditaires de Pierre Bernadau, référencé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux sous la côte Ms. 713 (XXXIII) pages 329 – 385 sous le titre « Montesquieu ou particularités remarquables et peu connues sur la vie et les écrits de Montesquieu », consulté sur les microfilms Mic 1698, XXXIII.
Les notes de bas de page correspondent aux propres renvois en bas de page de l’auteur, qui utilise pour cela les lettres de l’alphabet en majuscules (A, B, …).
Les notes, appelées dans le texte et regroupées en fin du document, sont des commentaires libres de diverses sources.
L’objet de cette transcription est de mettre à la disposition d’un plus grand nombre un texte qui n’existait jusqu’à présent que sous une forme manuscrite, écrit dans les années 1820 par le chroniqueur bordelais Pierre Bernadau, et consacré à la personne et à l’oeuvre de Montesquieu.
Après la mort de divers écrivains plus ou moins célèbres dans les deux derniers siècles, on a donné sous leurs noms des Ana. Celui de Montesquieu restait encore à faire. Nous en avons depuis longtemps recueilli les matériaux. Une partie a paru dans le Tableau de Bordeaux, que nous avons publié en 1810 (note 1). Maintenant nous allons ajouter à ce que nous imprimâmes alors les traits qui doivent compléter le Montesquiana. Il a pour objet :
1° la personne de Montesquieu,
2° ses ouvrages imprimés et manuscrits
3° un choix de ses lettres et pensées inédites
4° quelques bons mots et anecdotes caractéristiques de ce grand homme
5° la description du château dans lequel il est né et qu’il habitait ordinairement.
Ce recueil, divisé dans ces cinq paragraphes, ne contiendra rien qui ne soit digne de fixer l’attention publique, sous le rapport de la vérité, des convenances et de l’intérêt de la nouveauté.
§ 1
De la personne de Montesquieu
La commune de la Brède, qui est placée à trois lieues Sud-Ouest de Bordeaux, a été le berceau de Charles (note 2) Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu. Il y naquit de Jacques de Secondat et de Marie-Françoise de Pesnel, le 18 janvier 1689. Sa mère, dame très pieuse, voulut qu’il fût tenu sur les fonds baptismaux par un mendiant du pays, afin que cette circonstance lui rappelât, dans le cours de sa vie, que les hommes sont égaux devant Dieu.
Élevé au collège de Juilly, près de Meaux, Montesquieu annonça de bonne heure ce qu’il serait un jour. Son père ne négligea rien pour développer ces heureux présages, en veillant lui-même à l’éducation de son fils. En entrant dans le monde, il s’y fit distinguer par un esprit très orné et par la plus grande amabilité de caractère.
Destiné à la robe par sa famille il entra dans la magistrature dès qu’il eut atteint l’âge de la majorité. Il fut reçu au Parlement de Bordeaux, en qualité de Conseiller en 1715 et, deux ans après, en qualité de Président à mortier de la même cour. Il se défit de sa charge en 1726 parce que les devoirs qu’elle lui imposait lui parurent incompatibles avec les travaux que nécessitait la composition de ses ouvrages (note 3).
Il avait épousé, en 1715, Mademoiselle Jeanne de Lartigue, morte en 1768. De ce mariage sont issus un fils qui a écrit sur l’histoire naturelle et sur l’économie politique et deux filles dont une a été mariée à M. D’Armajan de Bordeaux (note 4) et l’autre à M. Godefroy de Secondat d’Agen. Cette dernière servait quelquefois de secrétaire à son père par la lecture qu’elle lui faisait pour soulager son lecteur ordinaire. Les livres mêmes les plus ingrats à lire, tels que Beaumanoir, Joinville et Froissart ne la rebutaient pas ; elle s’en divertissait souvent et égayait ses lectures en appuyant d’une manière agréable sur les vieux mots qui lui paraissaient risibles. Un jour Mademoiselle Montesquieu trouva sur la tablette de la cheminée de l’appartement de son père un volume des Lettres Persanes. Elle l’ouvrait pour le lire, lorsque Montesquieu lui dit : « Laissez ce livre, ma fille ; c’est un ouvrage de ma jeunesse : il n’est pas fait pour la vôtre. »
Après avoir été reçu à l’Académie française, Montesquieu entrepris de visiter les principaux états de l’Europe, afin d’observer dans ses résultats l’action des divers gouvernements qui y sont établis et de faire en quelque sorte sur les lieux l’application de ses théories aux institutions politiques dont il se proposait d’enseigner les éléments et leurs conséquences dans l’Esprit des lois. Pendant les quatre années que durèrent ses voyages, il parcourut la partie méridionale de l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Suisse, la Hollande et l’Angleterre. Il était en route pour la Turquie mais les circonstances politiques le forcèrent de s’arrêter à Belgrade, d’où il se rendit à Venise. Là, il rencontra le fameux Lord Chesterfield, qui lui fit jeter à l’eau des observations qu’il avait faites sur le gouvernement de cette ville, par suite d’une mauvaise plaisanterie dont on trouve tous les détails dans les mémoires du baron de Bésenval (note 5).
Dans le cours de ses voyages, Montesquieu reçut un accueil distingué des savants, des gens de lettres, des artistes célèbres, des hommes d’état, même des souverains. Étant allé faire ses adieux à Benoît XIV avant de quitter Rome, ce Pontife qui aimait les talents et l’auteur de L’Esprit des lois lui dit : « Mon cher Président, avant de nous quitter, je veux que vous emportiez quelque souvenir de mon amitié. Je vous donne la permission de faire gras pour toute votre vie, à vous et à toute votre famille ». Montesquieu remercie le pape et prend congé de sa sainteté. L’évêque camérier (note 6) le conduit à la daterie (note 7) ; on lui expédie les Bulles de dispense et on lui présente une note un peu forte des droits à payer pour ce pieux privilège. Le philosophe étonné de cet impôt rend au secrétaire son brevet en disant : « Je remercie sa Sainteté de sa bienveillance ; mais le pape est un si honnête homme que je m’en rapporte à sa seule parole et Dieu aussi ».
Montesquieu est mort à Paris le 10 février 1755 d’une fièvre maligne qui l’enleva en peu de jours. Il habitait alors rue Saint-Dominique, vis-à-vis l’hôtel de Tournon. Il est inhumé à Saint-Sulpice, dans la chapelle de Sainte Geneviève, N° 8 (notes 8 et 8 bis). Les étrangers désireraient qu’une inscription indique sa demeure à Bordeaux et à Paris (note 9), ainsi que le lieu où reposent ses cendres.
Il était blond, de taille moyenne, une corpulence très maigre quoique nerveuse et avait la vue extrêmement basse. Sa physionomie était riante et ressemblait beaucoup à celle de Cicéron et de Locke. Il était dans la société d’une douceur, d’une politesse, d’une gaieté toujours égales. Sa conversation était légère, agréable et instructive, par le grand nombre d’hommes et de peuples qu’il avait connus. Elle était coupée comme le style de ses ouvrages, pleine de sel et de saillies, sans amertume et sans satire. Personne ne racontait plus vivement, plus promptement, avec plus de grâce et moins d’apprêt. Il était sujet à de fréquentes distractions, mais elles n’étaient ni jouées, ni choquantes, ni importunes ; il en sortait toujours par quelque trait inattendu qui, en réveillant la conversation languissante, ne le rendait que plus aimable.
Buffon mettait Montesquieu au rang des cinq grands génies modernes, qu’il fallait distinguer de tous les autres ; mais son style lui paraissait trop laconique et trop peu développé. « Je l’ai beaucoup connu, disait-il à Hérault de Séchelles ; ce défaut tenait à son physique. Le Président était presque aveugle et il était si vif que la plupart du temps il oubliait ce qu’il voulait dicter, en sorte qu’il était obligé de se resserrer dans le moindre espace possible ». (Voyage à Montbard)
Le marquis d’Argenson décrit ainsi Montesquieu dans ses Loisirs d’un ministre d’état : « Il ne se tourmente pour personne et n’a point pour lui-même d’ambition. Il lit, il voyage, il amasse des connaissances, il écrit enfin et le tout uniquement pour son plaisir. Comme il a infiniment d’esprit, il fait un usage charmant de ce qu’il sait ; mais il met plus d’esprit dans ses livres que dans sa conversation, parce qu’il ne cherche pas à briller et ne s’en donne pas la peine. Il a conservé l’accent gascon, qu’il tient de son pays et trouve en quelque façon au-dessous de lui de s’en corriger. Il a conçu de bonne heure du goût pour un genre de philosophie hardie, qu’il a combiné avec la gaieté et la légèreté de l’esprit français et qui a rendu ses Lettres persanes un ouvrage vraiment charmant.
Le président de Montesquieu a quitté sa charge pour que sa non-résidence à Paris ne fût pas un obstacle à ce qu’il fut reçu à l’académie. Il a pris pour prétexte qu’il allait travailler à un grand ouvrage sur les lois. Le président Hénault, en quittant la sienne, en avait donné la même raison. On a plaisanté sur ces Messieurs, en disant qu’ils quittaient leur métier pour aller l’apprendre. En fait, Montesquieu voulait voyager pour faire des remarques philosophiques sur les hommes et les nations. Déjà connu par ses Lettres persanes, il a été reçu avec enthousiasme et empressement en Allemagne, en Angleterre et même en Italie. Nous ne connaissons pas toute l’étendue de la récolte d’observations et de réflexions qu’il a faites dans ces différents pays.
Il porte dans la société beaucoup de douceur, assez de gaieté, une égalité parfaite, un air de simplicité et de bonhomie qui, vu la réputation qu’il s’est déjà faite, lui forme un mérite particulier. Il a quelquefois de la distraction et il lui échappe des traits de naïveté qui le font trouver plus aimable, parce qu’ils contrastent avec l’esprit qu’on lui connaît. »
Le meilleur portrait de Montesquieu est celui qui se trouve dans l’Histoire de Bordeaux. Il est exécuté d’après la médaille gravée par Dassier en 1753 (note 10). C’est d’après cette médaille qu’a été fait le buste en marbre de l’auteur de L’Esprit des lois qui se voit à la bibliothèque publique de Bordeaux. Il a été sculpté par JB Lemoyne aux frais du prince de Beauveau, alors commandant de la Guyenne, qui voulut bien se charger d’accomplir le dessein qu’avait conçu l’académie des sciences de cette ville, pour ériger un monument en l’honneur de Montesquieu. Sur le socle de ce buste on lit l’inscription suivante :
En 1778, le corps municipal de Bordeaux avait délibéré de faire faire en marbre le buste de Montesquieu, d’après la statue que le roi avait ordonné d’ériger au Louvre dans la galerie des illustres français. Ce buste, qui devait être placé dans une des salles les plus apparentes de l’Hôtel de ville n’a jamais exécuté.
Le 22 avril 1822, on a inauguré dans une salle du palais de justice de Bordeaux, la statue de Montesquieu, dont le gouvernement a fait présent à cette ville. Cette statue, qui est en marbre blanc et un peu au-dessus de la grandeur naturelle, représente un magistrat debout et dans l’attitude de la méditation, tenant à la bouche une plume, qui semble vouloir prendre de la main droite. On aurait dû graver, sur le socle, le nom de Montesquieu, car la figure n’a aucune ressemblance avec celle de ce grand homme, dont il existe cependant des portraits en tout genre qui sont reconnus pour être très fidèles.
§ 2
Des ouvrages de Montesquieu
Ils sont assez connus pour que nous nous croyions dispensés d’en donner l’analyse. Nous nous bornerons à consigner, dans ce paragraphe, quelques particularités historiques et bibliographiques sur les principales éditions de ceux qui ont été publiés et sur l’objet de ceux qui sont encore manuscrits. Nous suivrons, pour ces éclaircissements, l’ordre de date de l’impression ou de la composition des divers écrits de Montesquieu.
I. La première et la meilleure édition des Lettres persanes est celle qui a été imprimée à Cologne en 1721 en 1 volume in-12. Cet ouvrage a été traduit en anglais en 1734, en russe deux ans après et en espagnol en 1818.
Dans sa jeunesse, Montesquieu étant obligé par son père de passer toute la journée sur le code, se trouvait le soir si excédé de cette étude que, pour se délasser, il composait une Lettre persane qui coulait de sa plume sans effort. Le régent, qui était maltraité dans ce livre, dit un jour à l’auteur : « Monsieur le Président, vos lettres persanes sont pleines de bonnes choses ; que vous ont-elles coûté à composer ? » – « Le papier, Monseigneur », répondit Montesquieu.
II. Le temple de Gnide parut pour la première fois en 1730 à Amsterdam, 1 volume in-12. Il y en a une édition dont le texte est gravé par Drouet, avec figures par Lemire et Eysen Paris, 1772, in-4. Cet ouvrage a été traduit en italien par Yespasinne ; Paris, 1762,1 volume in-12 ; K. Colardeau et Léonard l’ont mis en vers français.
On apprend par la 7° Lettre familière de Montesquieu que l’auteur avait tenu secrète pendant 10 ans la composition du Temple de Gnide et qu’il avait fait ce livre d’après une idée à laquelle la société de la princesse de Clermont avait donné lieu. On ne peut refuser à Montesquieu l’éloge d’avoir respecté les mœurs dans un écrit consacré à la plus impétueuse des passions et d’avoir, comme il le dit ailleurs, tempéré la volupté par la pudeur qui est la première des grâces.
III. De retour de ses voyages, Montesquieu se retira pendant deux ans à sa terre de la Brède, où il mit la dernière main à sa Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. La première édition de ce livre est de 1734, Amsterdam, 1 volume in-12. Il a été traduit en italien par Kelli-Dagani et en latin par Olaüs de Dalin, savant suédois.
IV. L’Esprit des lois fut imprimé d’abord à Genève en 1748, 2 volumes in-4 et 3 volumes in-12 par les soins du pasteur Jacob Vernet, ami de l’auteur, qu’il avait chargé de revoir les épreuves et qui changea quelques expressions du manuscrit, parce qu’elles n’étaient pas en français de Genève. Montesquieu rétablit les changements et fit quelques corrections à cet ouvrage, dans l’édition qu’il fit faire sous ses yeux à Paris l’année suivante et qui porte l’adresse de Leyde. Cette édition est en 2 volumes in-4 et 4 volumes in-12 ; c’est la seule que l’auteur ait avouée. On recherche ensuite celle d’Amsterdam, faite en 1758 sur les corrections que Montesquieu avait lui-même remis aux libraires avant sa mort.
Il a été publié deux éditions annotées de l’Esprit des lois, chacune en 4 volumes in-12. L’une a paru en 1764 à Amsterdam avec des remarques politiques et philosophiques d’un anonyme (note 11) ; l’autre, datée de Londres, en 1769, contient la critique des remarques de l’anonyme avec une table des matières et a été donné par d’Alembert.
Dans sa 28e Lettre familière, Montesquieu parle ainsi de ses travaux : « Il est vrai que le sujet de l’Esprit des lois est grand et beau ; je dois bien craindre qu’il n’ait été beaucoup plus grand que moi. Je puis dire que j’y ai travaillé toute ma vie. Au sortir du collège, on me mit dans les mains des livres de droit ; j’en cherchais l’esprit ; je travaillais et ne faisais rien qui vaille. Il y a 20 ans que je découvris mes principes : ils sont très simples. Un autre, qui aurait travaillé autant que moi, aurait mieux fait que moi. J’avoue que cet ouvrage a pensé me tuer. Je vais me reposer ; je ne travaillerai plus. »
V. A peine l’Esprit des Lois parut-il qu’il fut l’objet de plusieurs critiques. Celle qui affecta le plus l’auteur émanait d’un parti alors puissant en France et pouvait occasionner beaucoup de désagréments à Montesquieu. La Sorbonne même, excitée par ce qu’imprimait contre lui le journal de Trévoux et les Nouvelles ecclésiastiques, se proposait de soumettre à son examen l’Esprit des lois comme si c’eût été un livre de controverse. Dans ces conjonctures, Montesquieu se détermina à répondre à ces critiques, de peur que, s’il continuait à garder le silence comme il le dit lui-même, plusieurs personnes n’en eussent conclu qu’il y était réduit. Il publia, en 1750, la Défense de l’Esprit des lois, Amsterdam, 1 volume in-4 et in-12 de 100 pages. C’est la seule édition de cet écrit qui ait été imprimée séparément.
« La Sorbonne, peu contente de l’ouvrage de ses Députés, lit-on dans la 43e Lettre familière de Montesquieu, en a nommé d’autres pour réexaminer l’Esprit des lois. Je suis là-dessus extrêmement tranquille. Ils ne peuvent dire que ce que le Nouvelliste ecclésiastique a dit et je leur dirai ce que j’ai dit au Nouvelliste. Ils ne sont pas plus forts avec ce Nouvelliste et ce Nouvelliste n’est pas plus fort avec eux. Il faut toujours revenir à la raison : mon livre est un livre de politique et non un livre de théologie. Leurs objections sont dans leur tête et non dans mon livre ».
VI. Après la mort de Montesquieu, on a imprimé ses Lettres familières. L’abbé de Guasco, intime ami de l’auteur, les publia à Florence en 1769,1 volume in-12. On doit rechercher les éditions antérieures à celle de 1775 qu’une personne alors en crédit trouva le secret de faire falsifier. Ce petit recueil ne fait rien pour la gloire de l’auteur de l’Esprit des lois, mais il fait connaître des particularités curieuses sur sa vie.
VII. Les œuvres posthumes de Montesquieu ont paru pour la première fois en 1784, dans la collection complète de cet auteur, qui a été publiée à Paris, en 4 volumes in-4, avec une carte géographique des lieux dont il est parlé dans l’Esprit des lois. Ces ouvrages posthumes avaient été communiqués par le fils de Montesquieu. On les a imprimés ensuite séparément en 1 volume in-12. Les morceaux les plus remarquables de ce recueil sont : 1° un discours prononcé à la rentrée du Parlement de Bordeaux, en 1725, 2° un Fragment sur le goût, inséré dans l’encyclopédie, intitulé Arsace et Isménie. À l’égard de cette dernière production, Montesquieu écrivait en 1754 à l’abbé de Guasco : « Tout bien considéré, je ne puis me déterminer encore à livrer mon roman à l’impression. Le triomphe de l’amour conjugal en Orient est peut-être trop éloigné de nos mœurs pour croire qu’il serait bien reçu en France ».
En 1798 il a été publié un volume de nouveaux écrits posthumes de Montesquieu, dans lequel il n’y a de remarquable qu’une dissertation sur la politique des Romains dans la religion. Ce recueil est destiné à servir de supplément aux différentes éditions in-12 de cet auteur, qui ont paru jusqu’alors et est extrait de celle qui a été donnée par Plassau, dont nous parlerons plus bas.
VIII. Il y a un grand nombre d’éditions des œuvres de Montesquieu qui ont été imprimées en
divers lieux et formats. La première est celle d’Amsterdam (Paris), 1758, 3 volumes in-4. Elle a été publiée par le savant libraire Richer, sous la direction du fils de l’auteur. Les plus remarquables ensuite sont celles ci après citées :
1° Londres, 1767, 3 volumes in-4, avec figures données par le libraire Moreau qui avait été secrétaire de Montesquieu.
2° Paris (Didot), 1764, 4 volumes in-4 avec quelques écrits posthumes de l’auteur.
3° Lyon, 1792, 1 volume in-12.
Il n’y a que le texte de l’auteur sans les remarques philosophiques et politiques d’un anonyme qui ont été publiées pour la première fois dans l’édition de l’Esprit des lois imprimée à Amsterdam, 1754. On attribue ces remarques à Elie Luzace.
4° Paris, 1795,12 volumes in16 avec des notes de Helvétius sur l’Esprit des lois et des pensées diverses extraites des manuscrits de l’auteur, édition dirigée par l’abbé de la Roche.
5° Paris (Plassau), 1798, 5 volumes in-4, grand papier velin, belle édition augmentée de nouveaux écrits posthumes de l’auteur, et ornée de son portrait et de 15 gravures exécutées d’après les dessins des meilleurs artistes.
6° Paris (Creyvelet) 1816, 6 volumes in-8. « Cette édition, lit-on dans la bibliothèque d’un amateur, contient beaucoup de gravures et de feuilles, l’une imprimée à 14 exemplaires, contenant trois lettres de Montesquieu, l’autre tirée à 100 exemplaires, contenant des notes sur l’Angleterre qui paraissent être de cet auteur. »
7° Paris (Lequien), 1819, 8 volumes in-8.
IX. Montesquieu a laissé en manuscrits : 1. Les matériaux de l’Esprit des lois formant 20 gros volumes ; 2. plusieurs cahiers écrits de sa main intitulés : Morceaux qui n’ont pu entrer dans l’Esprit des lois et qui peuvent former des dissertations particulières ; 3. Sermons pour être prêchés par … ; 4. le Métempsicosiste, petit roman dans le genre du Zadig de Voltaire, mais inférieur pour la grâce et l’enjouement ; 5. Mes Pensées, 2 gros volumes reliés chacun de 100 pages au moins : on est frappé, en les parcourant, de la prodigieuse quantité de livres que Montesquieu avait lus et des observations profondes que les plus frivoles lui ont fait naître ; 6. Fragments sur la vie de Louis XI, 1 volume in-4. On lit dans le numéro 6 des Archives littéraires que dans toutes les oeuvres imprimées de Montesquieu, il n’y a peut-être pas un morceau pensé et écrit aussi fortement que ces Fragments. L’auteur commence par tracer un tableau de la situation politique de l’Europe lorsque Louis XI monta sur le trône et indique ensuite les grandes et belles choses qu’il aurait pu faire et qu’il n’a pas faites ; « Mais, dit-il, il ne vit dans le commencement de son règne que le commencement de sa vengeance ».7. Mémoires de mes voyages. Montesquieu parle ainsi de ce manuscrit dans sa 56e lettre : « A l’égard de mes voyages, je vous promets que je les mettrai en ordre dès que j’aurai un peu de loisirs et nous deviserons à Paris sur la forme que je leur donnerai. Il y a encore un peu trop de personnes dont je parle vivantes pour publier cet ouvrage ». La mort l’empêcha d’y mettre la dernière main et c’est ainsi que nous sommes privés de l’itinéraire d’un homme qui savait voir où les autres ne font que regarder. 8. Suites des Persanes ; il y a 41 lettres relatives aux affaires de France jusqu’au ministère du cardinal de Fleuri ; 9. Observations sur Arrien. Dans ses derniers séjours à la Brède, Montesquieu avait fait faire plusieurs extraits concernant l’histoire grecque.
§3
Choix de lettres inédites et de pensées de Montesquieu
Montesquieu avait une correspondance très étendue ; on doit regretter qu’on n’ait put en découvrir encore que la plus petite partie (note 13). Ces lettres qui ont été publiées portent toutes le cachet particulier aux autres écrits de cet auteur et servent à faire connaître quelques circonstances de sa vie. Les neuf lettres que nous donnons ici n’ont encore été imprimées dans aucune collection de ses œuvres.
Lettre à Helvétius, datée de St. Seurin, le 11 février 1749.
« L’affaire s’est faite et de la meilleure grâce du monde. Je crains que vous n’ayez eu quelque peine là-dessus et je ne voudrais pas en donner à mon cher Helvétius. Mais je suis bien aise de vous remercier des marques de votre amitié. Je vous déclare de plus que je ne vous ferai plus de compliments ; et au lieu des compliments qui cachent ordinairement les sentiments qui ne sont pas, mes sentiments cacheront toujours mes compliments.
Faîtes mes compliments, nos compliments, à notre ami Saurin. J’ai « usurpé » sur lui, je ne sais comment, le titre d’ami et me suis venu fourrer en tiers. Si vous autres me chassez, je reviendrai : tamen usque recurres. A l’égard de ce qu’on peut reprocher, il en est comme des vers de M. de Crébillon, tout cela a été fait 15 ou 20 ans auparavant.
Je suis encore admirateur de Crébillon, et je ne sais comment cette pièce m’inspire du respect. Sa lecture m’a tellement ravi que j’ai été jusqu’au 5° acte sans y trouver de défauts, ou du moins sans les sentir. Je crois bien qu’il y en a beaucoup, puisque le public y en trouve beaucoup ; d’ailleurs je n’ai pas de grandes connaissances pour les choses du théâtre et de plus il y a des vers qui sont faits pour certain genre dramatique et le mien en particulier est fait pour celui de Crébillon. Et comme dans ma jeunesse je devins fou de Rhadamiste (note 14); j’irais aux petites maisons pour Catilina. Jugez si j’ai eu du plaisir, quand j’ai entendu dire que le caractère de Catilina était peut-être le plus beau qu’il y ait au théâtre.
En un mot, je ne prétends pas donner mon opinion pour les autres. Quand un sultan est dans son sérail, va-t-il choisir la plus belle ? Non. Il dit je l’aime, je la prend ; voilà comment décide ce grand personnage.
Mon cher Helvétius, je ne sais point si vous êtes autant au-dessus des autres que je sens, mais je sens que je suis au-dessous de vous par l’amitié. »
Lettre à M. Risteau (note 15), négociant Bordeaux, datée de Paris, le 19 mai 1757.
« Les éloges flatteurs que vous donnez à mon livre, Monsieur, me consolent un peu des critiques qu’il a essuyées. Mais je ne puis penser comme vous sur le despotisme. Un gouvernement qui est à la fois l’état et le prince vous paraît chimérique ; je pense au contraire qu’il est très réel et je crois l’avoir peint d’après la vérité.
Je ne sais pas si les sujets d’un despote ont des biens qui soient à eux ; je sais seulement qu’ils ne peuvent avoir aucune vertu qui leur soit propre. La corruption et la misère arrivent de toutes parts dans les états où il règne. Il y a aussi loin du despote au véritable roi que d’un démon à un ange. Il est vrai qu’il peut y avoir de graves abus dans la monarchie, mais c’est lorsqu’elle se tourne en despotisme.
Je vous en dirai davantage lorsque je vous verrai à Bordeaux. Je n’ai que le temps de vous dire que je vous chéris autant que je vous estime. ».
Lettre à M. Barbot, Président de la cour des Aydes de Bordeaux, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences de la même ville, datée de la Brède, 8 mars.
« J’ai eu il y a quelques jours, mon cher président, un entretien avec M. Roux, médecin très estimable qui m’a donné en communication un mémoire sur les dangers de la petite vérole. Cet homme mérite secours et protection. Je lui ai conseillé de quitter la province ou rarement on apprécie le vrai mérite et je lui ai promis des lettres de recommandation pour quelques amis de Paris. Rapprochez-vous de cet homme, il est de la bonne espèce et mérite d’être connu.
J’ai lu votre dissertation sur l’esprit. Personne mieux que vous ne peut traiter cette matière. C’est un meurtre que d’enfouir les jolies choses que vous faites. Il y a longtemps que je vous le dis et cela ne vous corrige pas. Vous êtes toujours le même et je ne compte plus de vous punir de votre modestie. C’est une maladie incurable, qui privera le public de vos bonnes productions.
On dit qu’il circule à Bordeaux un ouvrage dirigé contre l’Intendant de la province. Tâchez de vous le procurer et faites le moi passer. Ces sortes d’écrits font connaître le siècle où l’on vit : il faut les lire et les brûler.
Les braconniers chassent sur nos terres ; ces vagabonds sont sans respect pour les propriétés et font plus de mal à nos moissons que les renards et les blaireaux. On sera obligé de tendre des pièges pour diminuer l’espèce de ces animaux bipèdes … »
Lettre à M. Brescon, médecin à Mézin, qui avait envoyé à Montesquieu une ode à la louange du duc d’Aiguillon.
« L’ode que vous avez eu la bonté de m’envoyer, Monsieur, est digne du héros et du poète. Vous êtes l’Homère d’un nouvel Achille, aussi courageux, mais plus aimable que l’ancien. Continuez de cultiver les muses, elles demandent la jeunesse ainsi que les grâces. Jouissez longtemps des faveurs des unes et des autres.
Je ne vois plus votre ami M. T. et j’en suis fâché, car je l’aimais pour lui-même et par reconnaissance des avantages qu’il m’a procurés, en me liant à vous. »
Lettre au même.
« Vous avez envoyé, Monsieur, un bâton à un aveugle, en m’adressant votre Traité des maladies de la vieillesse. Je puis encore dire avec plus de vérité qu’Horace :
Ehue ! Fugaces, Posthume, Posthume
Labunctur anni.
Votre livre sera le guide des vieillards et il apprendra aux jeunes gens à ne pas se préparer, par la dissolution, de nouvelles infirmités pour cet âge avant-coureur de la mort. »
Lettre au même qui avait envoyé à Montesquieu un éloge en vers, datée de Baron, 25 février 1752.
« Vous voyez, Monsieur, que je ne fais pas si facilement de la prose que vous faites des vers. Il paraît que vous n’avez pas besoin d’être soutenu par votre sujet, puisque vous me louez ; j’ai lu avec bien du plaisir votre lettre et que je me rappelle avec non moins de plaisir l’homme d’esprit qui l’a écrite. »
Lettre au même qui avait prié Montesquieu de le proposer pour une place à l’Académie de Bordeaux, datée de Raymond, le 23 mars 1752.
« J’écris, Monsieur, à M. le Président Barbot de vous proposer et je lui envoie l’article de votre lettre sur les faunes et les sylvains. Je vois qu’il fera avec plaisir ce que je lui demande et que vous lui demandez.
J’ai lu avec une véritable satisfaction le succès de votre pratique sur les maladies épidémiques de votre pays et je copie encore cet article dans ma lettre à M. le président Barbot afin qu’il en fasse part à l’Académie et que votre nom soit célébré dans cette terre comme dans la vôtre. »
Lettre au même, datée de Lartigue, le 3 novembre 1752.
« Vous trouverez, Monsieur, que je fasse réponse bien tard à votre lettre du 24 novembre. J’ai été toujours à cheval depuis ce temps-là et j’aurais bien été flatté de vous voir.
À l’égard de la dédicace de votre ouvrage, il vous faudrait un mécène qui valut mieux que moi et je dois renoncer pour vous à l’honneur que vous me faites. Quoi qu’il en soit, je ne regarderai que comme une pure marque de votre amitié l’honneur que vous voulez me faire et que je ne mérite guère de me mettre à la tête de votre livre.
Vous me surprenez beaucoup quand vous me dites que le président Barbot n’a égaré que deux de vos dissertations ; il vous en reste deux et j’admire votre bonheur. Il faut que le Président aie changé ou qu’il ait des attentions particulières pour vous ; à un autre, il les aurait égarés toutes quatre.
Ce que vous dites sur les Anglais est très bien et très sensé. Effectivement, ils aiment les grands hommes de leur patrie et dans cette nation extraordinaire, il y a peu de gens qui n’aient un coin de mérite personnel.
Lettre à l’évêque Warburthon, qui avait écrit à Montesquieu au sujet des œuvres philosophiques de Bolingbroke, datée de Paris, mai 1754.
« J’ai reçu, Monsieur, avec une reconnaissance très grande les deux magnifiques ouvrages que vous avez eu la bonté de m’envoyer et la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire sur les œuvres posthumes de mylord Bolingbroke. Et comme cette lettre me paraît être plus à moi que les deux ouvrages qui l’accompagnent, auxquels tous ceux qui ont de la raison ont part, il me semble que cette lettre m’a fait un plaisir particulier.
J’ai lu quelques ouvrages de Bolingbroke et, s’il m’est permis de dire comment j’en ai été affecté, certainement il y a beaucoup de chaleur, mais il me semble qu’il l’emploie ordinairement contre les choses et il ne faudrait l’employer qu’à peindre les choses.
Or, Monsieur, dans cet ouvrage posthume dont vous me donnez une idée, il me semble qu’il vous a préparé une matière continuelle de triomphe. Celui qui attaque la religion révélée n’attaque que la religion révélée, mais celui qui attaque la religion naturelle attaque toutes les religions du monde. Si l’on enseigne aux hommes qui n’ont pas ce frein, ils peuvent penser qu’ils en ont un autre, mais il est pernicieux de leur enseigner qu’ils n’en n’ont pas du tout.
Il n’est pas impossible d’attaquer une religion révélée, par ce qu’elle existe par des faits particuliers et que les faits de leur nature peuvent être matière de dispute. Mais il n’en est pas de même de la religion naturelle ; elle est tirée de la nature de l’homme, dont on ne peut discuter et du sentiment intérieur de l’homme, dont on ne peut disputer encore.
J’ajoute ceci : quel peut être le motif d’attaquer la religion révélée en Angleterre ? On l’a tellement purgée de tout préjugé destructeur, qu’elle n’y peut faire du mal et qu’elle y peut faire au contraire beaucoup de bien.
Je sais qu’un homme, en Espagne ou au Portugal, qu’on va brûler, ou qui craint d’être brûlé, parce qu’il ne croit pas certains articles dépendants ou non de la religion révélée, a un juste sujet de l’attaquer, parce qu’il peut avoir quelques espérances de pourvoir à sa défense naturelle. Mais il n’en est pas de même en Angleterre où tout homme qui attaque la religion révélée attaque sans intérêt et où cet homme, quand il réussirait quand même il aurait raison dans le fond, ne ferait que détruire une infinité de biens pratiques pour établir une vérité purement spéculative. »
II. Montesquieu pensait ainsi sur le commerce : L’esprit de commerce entraîne avec lui celui d’économie, de frugalité, de modération, de sagesse, de tranquillité, d’ordre et de règle. Tandis que cet esprit persiste, les richesses qu’il produit n’ont aucun mauvais effet. C’est la nature du commerce de rendre les choses superflues utiles et les utiles nécessaires. Le commerce est la profession des gens égaux.
Econome sans avarice, Montesquieu n’aimait pas les dissipateurs. Il était surtout révolté de la prodigalité de la plupart des colons américains qu’il voyait à Bordeaux dissiper en peu de mois des richesses considérables et qui retournaient chez eux laissant peu de regrets mais beaucoup de dettes. Il disait à ce sujet : « Ces gens-là viennent en France pour faire étalage de leurs trésors, ils n’étalent que leur sottise. »
« À l’âge de 35 ans, j’aimais encore, disait Montesquieu. J’ai été assez heureux pour m’attacher à des femmes que j’ai cru qui m’aimaient. Dés que j’ai cessé de le croire, je m’en suis soudain détaché. J’ai assez aimé à dire des fadeurs aux femmes et à leur rendre des services qui comptent si peu. »
Il regardait le jeu comme l’éteignoir de la conversation. « Depuis la fureur que les cartes ont excitée, disait-il, on ne parle plus. Les vieilles femmes mêmes sont devenues silencieuses. Le jeu, qui n’était chez elle qu’un prétexte dans la jeunesse, devient dans un âge avancé une passion qui dévore tous les autres plaisirs. »
Il pensait que pour plaire dans la société il fallait n’avoir pas cette sensibilité qui s’attache vivement. On lui disait un jour en parlant de Fontenelle : il n’aime personne. Il n’en est que plus aimable, répondit Montesquieu.
Terminons ce paragraphe par quelques réflexions détachées de celles que nous avons extrait du recueil des Pensées de Montesquieu.
Un flatteur, y lit-on, est un esclave qui n’est bon pour aucun maître – Quand dans un royaume il y a plus davantage à faire sa cour qu’à faire son devoir, tout est perdu – Le cardinal de Richelieu fit jouer à son monarque le second rang dans la monarchie et le premier dans l’Europe. Il avilit le roi, mais il illustra le règne – Les magistrats, dans quelque circonstance et pour quelque grand intérêt de corps que ce puisse être, ne doivent jamais être que des magistrats, sans parti et sans passion, comme les lois qui absolvent et punissent, sans aimer ni haïr – La plupart des choses ne paraissent extraordinaires que parce qu’elles ne sont pas connues – Un fonds de modestie rapporte un très grand fonds d’intérêt – L’amour-propre bien entendu était selon Montesquieu de ne point compromettre son mérite avec l’orgueil des autres. Il pratiquait cette maxime. Il portait dans la société un air de simplicité et de bonhomie qui faisait un contraste piquant et agréable avec le titre d’homme de génie que l’Europe lui avait donné. Il ne cherchait ni à briller dans la conversation, ni à éclipser les autres. Et c’est par cet heureux caractère qu’il se faisait pardonner sa supériorité. Il pensait qu’il en est des beaux esprits comme des hommes en place ; le respect leur est acquis, ils n’ont besoin que de se rendre aimable.
§4
Quelques bons mots et anecdotes caractéristiques concernant Montesquieu
La lettre suivante, dont nous croyons devoir enrichir le Montesquiana, nous a été adressée par l’auteur du Nouveau dictionnaire historique auquel nous avions communiqué notre dessein d’ajouter quelques particularités sur Montesquieu au Tableau de Bordeaux que nous avons publié en 1810.
« La composition de mon principal ouvrage, Monsieur, m’ayant obligé à divers correspondances, j’ai reçu plusieurs lettres de littérateurs et de gens du monde qui avait eu le bonheur de vivre avec Montesquieu. C’est avec plaisir que je vous fais part de quelques anecdotes que j’y ai recueillies concernant votre illustre compatriote. Les voici :
Montesquieu se trouvait à Montagnac prés de Nérac le jour de la fête patronale de ce village, dont son gendre était seigneur. Il assista aux offices de l’église ; après vêpres, il y eut sermon et l’orateur qui était un capucin fut long et ennuyeux. En sortant de l’église, le curé demanda au président son sentiment sur le prédicateur. Son sermon, répondit Montesquieu, avait en longueur ce qui lui manquait en profondeur.
Il dit à un homme qui lui attribuait des principes qui n’étaient point dans son Esprit des lois : « Vous jugez, Monsieur, le livre qui est dans votre tête et non celui qui est sorti de la mienne ».
On a imprimé que Montesquieu se plaignait que dans sa province il ne trouvait personne qui l’entendit et qu’il répétait souvent ce vers d’Ovide :
Barbarus hic ego sum, quia non intelligo illis
Cette supposition est un outrage fait à Bordeaux. L’auteur de l’Esprit des lois était trop poli et surtout trop juste pour se livrer à de pareilles plaintes, dans une ville où les diverses classes de la société renfermaient des hommes capables de l’apprécier, avec lesquels il se plaisait à vivre. Il voyait souvent le chevalier de Vivens (note 16) et il en faisait grand cas. Un jour, ce dernier lui témoignait le regret de le voir confiné dans le fond d’une province. Quand on vit avec vous, lui répondit Montesquieu, on sent moins le besoin des gens de lettres de Paris.
Il assistait à un sermon prêché par un jeune orateur qui passait pour avoir plus de mémoire que de génie. Le père Lagarde, à côté duquel il était, lui dit : Monsieur le président, voilà une belle pièce, je voudrais bien l’avoir faite. Et le prédicateur aussi, répliqua Montesquieu.
Un homme qui avait plus de zèle que d’esprit, ayant fait tomber la conversation sur la religion, sujet que Montesquieu craignait de traiter, lui dit avec vivacité : On ne voit plus aujourd’hui que des esprits forts … Eh ! Monsieur, interrompit le président d’un ton encore plus vif, il y a pour le moins autant d’esprits faibles et plats.
Une dame de Bordeaux très dévote, mais livrée à la mollesse, cherchait les directeurs les plus indulgents dans un ordre qui ne passait pas pour sévère. On voit bien, dit Montesquieu, qu’elle veut gagner le ciel, mais au meilleur marché possible.
Un conseiller du Parlement de Bordeaux, discutant avec lui sur un point de jurisprudence, lui dit : Il paraît, Monsieur le président, que vous suivez un peu trop la loi naturelle. Et vous Monsieur, répondit Montesquieu, vous ne suivez pas assez la raison naturelle.
Il n’était pas ennemi des plaisirs, ni même de ceux qu’un philosophe devrait s’interdire. Diderot disait qu’ils avaient été quelquefois dans des lieux qu’on ne nomme point. Il entretenait une Demoiselle de Paris, rue Saint-Honoré. Il lui écrivait quelquefois. L’abbé Pascalis, provençal d’une belle figure, que j’ai beaucoup connu, faisait les réponses pour la donzelle, dont il était l’amant secret.
J’ai aussi connu un bénédictin de Saint Maur qui, mécontent de son cloître, alla se cacher, pendant deux ans, à la Brède sous l’habit séculier. Montesquieu travaillait alors à sa Grandeur des Romains et le bénédictin payait son dû en faisant des recherches relatives à cet ouvrage. J’ai oublié le nom de ce bénédictin ; mais il ne parlait du président qu’avec enthousiasme.
Après la mort de la marquise du Châtelet, arrivée à Lunéville en 1749, Voltaire quitta la cour de Lorraine et prit une maison à Paris. Il y fit construire un théâtre où l’on essayait ses pièces nouvelles. On y représenta Morne sauvée, en présence d’une assemblée choisie. Montesquieu fut invité et à peine était-on au troisième acte que le président s’endormit. On le fit remarquer à Voltaire qui dit : Laissez-le dormir, il croit être encore à l’audience.
Le malheur de certaines lectures, disait Montesquieu, c’est qu’en lisant il faut se tuer à réduire ce que l’auteur a pris beaucoup de peine à amplifier.
On n’aura pas ce malheur à craindre, Monsieur, en lisant votre nouvel ouvrage, ou des faits nombreux sont racontés avec la précision convenable. Je désire qu’il sorte quelque avantage des anecdotes authentiques que je vous adresse sur Montesquieu. Je ne les ai détachés de mes manuscrits qu’en faveur de l’amitié ».
L. M. Chaudon (note 17)
Montesquieu était doux dans la société ; mais comme il avait la répartie prompte, il la rendait piquante quelquefois lorsqu’on affectait de pousser à bout. Il se trouva un jour chez le président Barbot avec un Bernardin, homme très superficiel mais beau parleur qui, ne craignant point de lutter avec l’auteur de l’Esprit des lois étaya quelques paradoxes de mauvaises raisons qu’il soutenait avec une certaine chaleur. Montesquieu lui dit : Vous ressemblez trop, mon père, aux héros de l’Arioste, qui combattaient pour des chimères avec des armes brillantes. Ce Bernardin n’en fut que plus animé dans la dispute, et il la tourna du côté de la théologie. Le président piqué et voyant qu’on cherchait à rendre sa religion suspecte parce qu’il avait rendu son adversaire ridicule, lui dit : Ne voudriez-vous pas imiter votre Saint et prêcher contre moi une croisade ? Mais personne ici ne prendra les armes pour vous.
Montesquieu aimait à parcourir les dépôts de vieux livres, mais, bien différent de certains bibliomanes, il ne profitait pas de ses trouvailles au détriment des bouquinistes. Un jour, après avoir visité le magasin du libraire Sayn à la Rochelle, il lui demanda s’il n’avait pas des bouquins. Celui-ci le conduisit dans son grenier qui en contenait une grande quantité. Montesquieu ayant trouvé deux ouvrages qui lui convenaient en demanda le prix au libraire qui les offrit pour un écu. Montesquieu dit à Sayn : « Les livres que j’ai choisis sont rares. En voilà un Louis parce qu’ils les valent. Je désire que personne n’abuse de votre facilité. Dans votre intérêt, j’ai mis à part quelques bouquins précieux où j’ai coté les prix. Si vous êtes sage, vous ne les donnerez pas à moins et surtout vous apprendrez un peu mieux la bibliographie. »
Parmi les auteurs que Montesquieu fréquentait le plus habituellement à Paris, on remarque Saurin, Dupré de Saint Maur, Castel, la Condamine, Fontenelle, Helvétius, Diderot. Il voyait aussi beaucoup Madame de Tancin, Geoffrin, Dupré de Saint Maur et la duchesse d’Aiguillon. Il disait de cette dernière dame et de Voltaire : ce sont deux personnes qui disent le plus de mensonges dans un temps donné.
Dans le recueil de ses pensées, Montesquieu parle aussi des distractions auxquelles il était sujet. Je n’ai pas été fâché de passer pour distrait, cela m’a fait hasarder bien des négligences qui m’auraient embarrassé. J’aime les maisons où je puis me tirer d’affaire avec mon esprit de tous les jours.
Montesquieu n’allait jamais dans ses terres sans en visiter les habitants de toutes les classes. Il parcourait tantôt un village, tantôt l’autre et savait le nom de tous les paysans auxquels ils ne parlait jamais qu’en Gascon. Il se plaisait à s’occuper de leurs intérêts. Pour mieux les connaître, il s’informait aux enfants des facultés de leurs parents. On l’a vu souvent aller vers ces derniers, leur proposer des moyens pour pacifier leurs querelles domestiques, pour arranger leurs affaires particulières et même pour leur porter des secours pécuniaires, sans que ces bonnes gens puissent savoir comment il avait pu être instruit de leur position.
Le 7 décembre 1750, étant à la Brède, il apprend que dans sa terre de Montesquieu, prêt de Nérac, les habitants étaient sur le point d’éprouver les horreurs d’une famine, comme celle qui avait désolé le bordelais deux ans auparavant. Il fait appeler un de ses voisins et le prie de bien vouloir l’accompagner dans un voyage secret, qui durera trois jours. Ils partent le lendemain en chaise de poste. Arrivé dans son château, Montesquieu invite les curés des quatre paroisses de sa terre à se rendre de suite chez lui pour une affaire très pressante. En attendant, il va dans son grenier à blé et fait mettre à part le grain nécessaire pour nourrir ses gens jusqu’à la récolte prochaine.
Lorsque les curés sont arrivés : « Messieurs, leur dit-il, je vous prie de m’aider à procurer quelque soulagement à vos paroissiens. Vous connaissez ceux qui manquent de blé et d’argent pour en acheter. Je veux que tout ce qui est dans mon grenier leur soit distribué gratis. Mon intendant délivrera la quantité de grains que vous vous fixerez, dans les ordres que vous donnerez, à mesure que les besoins vous seront connus. Il ne faut pas qu’on manque de nécessaire dans ma terre, quand j’y ai du superflu. » Les curés se confondent en éloges sur cette générosité et veulent proposer des moyens pour en répandre les effets. « Messieurs, vous êtes de braves gens et je m’en rapporte entièrement à vous pour faire cette distribution. Vous m’obligeriez de seconder promptement mes vues et qu’il n’en soit plus parlé. »
Montesquieu partit peu après et ne voulut même pas coucher au château (note 18) afin de se dérober aux remerciements de ses fermiers. L’ami qui l’avait accompagné dans ce voyage et dont le fils nous a communiqué cette anecdote a assuré qu’il fut donné, dans cette occasion, plus de 200 boisseaux de froment et que dans les marchés du pays le prix du grain était déjà monté à 32 francs le boisseau. Un pareil trait peut servir de pendant à celui qui fit de sujet de sa pièce du Bienfait anonyme.
§ 5
Description du château de la Brède
L’auteur de l’Esprit des lois ne prit le nom qu’il a tant illustré qu’alors qu’il succéda aux biens et à la charge du président de Montesquieu, son oncle paternel. Dans sa jeunesse, il se faisait appeler le baron de la Brède, de la terre ainsi nommée, qu’il choisit dans la suite pour sa résidence. Le château qu’il habitait étant devenu un objet de curiosité pour les voyageurs de toutes les nations, nous avons cru devoir en donner une description succincte.
Il est situé à 10 minutes de marche de l’église de la commune de la Brède. De vastes prairies au levant, au midi, à l’est, au nord, une agréable charmille et un grand bois de haute futaye, percées d’allées qui se croisent symétriquement, entourent ce château. Sa construction date du commencement du XVe siècle. Il présente à l’extérieur un dodécagone irrégulier d’environ 150 pieds de diamètre sur 60 d’élévation. Deux grosses tours flanquent son entrée au nord. On y parvient après avoir passé sur trois ponts-levis disposés en demi-lune. Ils s’appuient sur ses ouvrages avancés qui sont défendus par un bastion en forme de plate-forme et par une tour crénelée. Ces ouvrages s’élèvent au milieu de fossés profonds, de 30 pieds de largeur, couronnés d’un bon parapet. Ces fossés cernent entièrement le château et sont remplis d’eau vive, qui de là est dirigée, par divers aqueducs et canaux, dans toutes les parties des avenues dont nous avons parlé. C’est Montesquieu qui avait fait faire lui-même ces avenues à son retour d’Angleterre où il en avait pris l’idée. Il y travailla, pendant trois ans, avec l’abbé de Guasco, son ami, et il se plaisait beaucoup dans ces travaux comme on le voit en plusieurs endroits de ses Lettres familières.
Sur la porte d’entrée du château de la Brède, on lit l’inscription suivante, gravée sur une plaque de marbre blanc (note 19) :
Berceau de Montesquieu, séjour digne d’envie,
où d’un talent sublime il déposa les fruits,
lieux si beaux, par le temps vous serez tous détruits,
mais le temps ne peut rien sur ce divin génie.
Quoique cette inscription porte, on ne sait pourquoi, la date de 1774, elle n’a été mise sur la porte de ce château qu’en 1814, et c’est l’état-major de l’armée anglaise, qui entra dans Bordeaux le 12 mars de cette dernière année, qui la fit faire ses frais.
L’intérieur du château ne répond pas à sa situation romantique. On entre d’abord dans une petite cour où se présentent deux portes assez basses. Celle qui est à gauche conduit par un étroit et obscur corridor à une chambre d’environ vingt pieds carrés. C’était la salle à manger de Montesquieu. Elle est garnie d’un modeste ameublement comme chaises à hauts dossiers, fauteuils à bras couverts d’étoffes brunes à grand ramage, canapé garni en velours ciselé à franges grises. La cheminée est de forme simple et peinte en marbre. Sur sa tablette est le bougeoir de Montesquieu. On préférerait y trouver le manuscrit de quelques uns des couplets qu’il composait dans les réunions de société.
Cette pièce communique à une autre un peu moins grande, mais également boisée, peinte et meublée à l’ancienne mode. C’était la chambre à coucher de Montesquieu. On y a conservé en entier son lit. Il est à quatre quenouilles. Le ciel, le dossier et la courtepointe sont en satin vert piqué et les rideaux en coton rouge. Au-dessus d’un canapé également en soie verte est un médaillon ovale en cuivre bronzé d’environ deux pieds dans son plus grand diamètre. Il offre en fort relief la tête de Montesquieu, exactement semblable à la médaille frappée par Dassier en 1751. Ce doit être celui dont parle M. de Secondat dans une Lettre qui se trouve imprimée à la suite de celles de son père.
Au milieu de quelques portraits de familles qui sont dans cette chambre est une glace de moyenne grandeur, entourée d’une large bordure et d’un grand couronnement, le tout en bois de noyer. Ce miroir était le meuble dont Montesquieu se servait le moins, car il était fort négligé dans son habillement. Au-dessous on voit sa table à écrire près de la cheminée et une vieille chaise où il s’asseyait. Sur le jambage droit de cette cheminée, on remarque non seulement que la peinture a été enlevée par le frottement du pied que Montesquieu y appuyait pour écrire sur son genou lorsqu’il était au coin du feu, mais encore l’empreinte de son pied qu’il tendait très élevé parce qu’il avait la vue basse.
Il y a dans cette chambre les divers meubles qui ont servi à Montesquieu. C’est M. de Secondat qui a le premier voulu qu’on laissa le château de la Brède dans l’état où il était à la mort de son illustre père. On doit lui savoir gré de cette attention.
De cette chambre, on monte par un petit escalier dans un corridor aboutissant à une vaste salle qui est au premier étage du château. Elle a 50 pieds de longueur sur 32 de largeur et sa plus grande hauteur est de 40 pieds, étant couronnée d’une voûte en lambris demi-circulaire, en bois qui paraît n’avoir jamais été peinte.
Cette pièce, qui ressemble à une église de campagne, servait sans doute de salle d’armes en temps de guerre. Montesquieu lui avait donné une autre destination : Il y avait établi sa bibliothèque. On dit que ses livres sont contenus dans les neuf grandes armoires à deux portières qui sont dans cette salle. Ces armoires sont fermées à clé et les panneaux en sont remplacés par des treillis de fils de fer recouverts de rideaux en dedans. Puisqu’il n’est pas possible d’entrevoir ses livres dans cette bibliothèque, il serait à désirer qu’on en ait au moins dressé le catalogue et qu’il fût exposé aux curieux, à côté du plus simple exemplaire des œuvres de Montesquieu.
Une vingtaine de portraits, plus ou moins dégradés, de magistrats, de militaires, de gens d’église, d’hommes et de dames de cour (tous dans le costume français du temps de Louis XIV ou de la régence), ainsi que beaucoup de chaises et fauteuils de différentes formes et une charpente de vieux billard, meublent cette pièce dont l’état de délabrement et de désordre affecte désagréablement. Il est présumable que ces divers effets proviennent de plusieurs autres endroits du château et qu’ils ont été réunis là comme dans un garde-meuble. Ils ont bien pu servir à Montesquieu, mais ils n’étaient vraisemblablement pas dans cette salle de son vivant. On ne peut pas croire qu’il aimât à y travailler si elle eût été dans l’état actuel ou qu’il voulût y recevoir la visite des personnes de considérations qu’il voyait habituellement.
A l’un des bouts de cette salle est une vaste cheminée, dont le manteau, qui s’élève au-dessus de la hauteur de l’homme, est soutenu par de petites colonnes en pierre. La construction de cette cheminée paraît aussi ancienne que celle du château. À l’autre bout et dans l’angle septentrional est une porte entourée d’ornements gothiques qui ouvre dans une petite chapelle domestique. On y voit un hôtel assez moderne, simplement décoré, avec quelques tableaux de piété. La seule chose qu’on n’y remarque est un vieux prie-Dieu en bois de noyer, formé d’une petite armoire, semblable à ceux qu’on trouve encore dans des sacristies d’églises de campagne. Ce prie-Dieu est au milieu de la chapelle. Il servait à Montesquieu lorsqu’on y disait la messe. Au milieu du lambris, on a peint les armes de la famille de Secondat.
Les quatre pièces que nous venons de décrire sont les seules qui fixent l’attention des curieux, parce qu’on y a conservé des objets qui apprennent qu’elles ont été habitées par un grand homme. On compte d’ailleurs une vingtaine de chambres dans ce château. Elles servent au propriétaire qui y réside. C’est actuellement M. le baron de Montesquieu, petit fils de l’auteur de l’Esprit des lois.
Le château de la Brède n’est point curieux par lui-même. Au-dedans, il est mal distribué et n’a rien de ce qui peut en rendre la demeure agréable. Sa forme extérieure est irrégulière, bizarre et ne ressemble à aucune construction de ce genre, soit gothique, soit moderne. Son placement au milieu d’une grande masse d’eau, qui jadis ont contribué à sa sûreté, en fait un séjour triste et malsain. L’horizon de verdure qui ceint ce sombre donjon, l’isole des lieux que l’habitation ou les travaux de l’homme animent. Mais lorsqu’on songe que ce château modeste fut la demeure du plus beau génie de son siècle, qu’au sein de cette solitude le code des nations fut médité pour le bonheur de l’humanité, aussitôt la scène change, s’embellit et l’on croit voir dans ce vieux donjon, au milieu de ces vastes bois, errer l’ombre auguste du grand homme qui, après avoir peint si agréablement les ridicules des Français et les jeux fortunés de Gnide, devina les causes de la prospérité et de la chute de l’empire romain et appris aux peuples sur lesquelles bases il devait asseoir une législation heureuse, forte et durable. La Brède devient un nouvel Élysée dont Montesquieu est la divinité.
En 1822, nous y avons fait les vers suivants pour caractériser les divers écrits de ce philosophe :
Au monde il révéla l’origine des lois ;
Sous un masque persan des abus il peut rire.
Il peignit des Romains les malheurs et les droits,
Et sage et aimable, il adoucit sa voix,
Pour célébrer, dans Gnide, les amours et Thémire.
Nous avions terminé ces vers par une pointe galante, afin qu’ils fussent lus par les femmes, qui ne lisent pas même le temple de Gnide de cet auteur.
Dans un second voyage à la Brède, nous fîmes corrections à cette inscription en la terminant par une pensée plus mâle que la première. Tout cela ne paraîtra pas inspiré par le génie du lieu que nous visitions. Au reste, voici notre nouvelle édition :
Au monde il révéla l’origine des lois ;
Sous un masque persan il instruit sa patrie ;
Dans l’orgueil du triomphe il voit Rome aux abois,
Et alors même qu’à Gnide il déguise sa voix,
Toujours dans ses écrits respire le génie.
Autre inscription pour le portrait de Montesquieu.
Il montre aux nations la source de leurs lois,
Sous un masque persan des français il sait rire,
Dans l’orgueil du triomphe il voit Rome aux abois ;
Et soit qu’à Gnide, à Bactre il déguise sa voix,
Dans ses moindres écrits le génie respire.
COMMENTAIRES
note 1 (Gérard Lacoste)
« Parce que la mode insolente du temps était au dictionnaire, le très prolifique érudit bordelais Pierre Bernadau voulut dresser en 1787 dans son « Aquitaine Littéraire » un tableau complet des auteurs aquitains, de l’Antiquité au XVIII° siècle. Il n’osa pas rédiger de suite l’article sur Montesquieu dont les Bordelais s’arrachaient les oeuvres pour enrichir leurs bibliothèques, mais Bernadau n’hésita pas en revanche à souligner que son fils, Jean Baptiste de Secondat, avait pour sa part écrit des « Observations sur les eaux minérales » et qu’on pouvait lui attribuer les vers de Racine : Et moi fils inconnu d’un si glorieux père. »
in Revue française d’Histoire du Livre, n° 128, 2007, DROZ, Société des bibliophiles de Guyenne, article de François Cadilhon. La Bibliothèque de Jean Baptiste de Secondat.
note 2 (Michel Colle)
Dans ce texte de 1823, Bernadau ne cite pas le deuxième prénom de Montesquieu, Louis, qu’il prétend avoir « découvert » en 1849, comme il l’écrit dans ses Tablettes à la date du 17 février 1849.
« J’insère dans le courrier de la Gironde une médaille rare, qui m’a été demandé. Cette médaille fait connaître un prénom jusqu’alors inconnu de l’auteur de l’Esprit des lois et une fondation scientifique par lui faite pour un prix qu’il donna vers 1740 pour être distribué par l’ancienne Académie de belles lettres, sciences et arts de Bordeaux. Je prouve, par cette pièce sur laquelle sont les armoiries de Montesquieu, qu’à son prénom de Charles, qui était jusqu’à présent seul connu, il faut ajouter celui de Louis que je viens de découvrir; j’invite l’autorité à faire graver ces deux prénoms sur l’inscription à mettre sur le monument qu’on va lui ériger à Bordeaux. Cette médaille, qui est de grand module, est très rare dans cette ville; aucun de nos archéologues, qui cherchent partout des sujets pour faire des phrases académiques, n’en ont encore pas dit un mot. » Pierre Bernadau, Collection héréditaire de mes oeuvres, tome XII, 17 février 1849, page 499, Bibliothèque municipale de Bordeaux Ms. 713 (XXXIII) (MIC 1698/12).
Cette note est parue dans le Courrier de la Gironde du 17 août 1849.
note 3 (Monique Brut)
Bernadau donne son interprétation. Montesquieu a cédé, à cette époque, la partie « commerciale » / vénale de la dite charge. Il s’ y ennuyait profondément, avait besoin d’argent, il espérait décrocher un poste d’Ambassadeur et donc, il cherchait à financer son Grand Tour (même en étant très raisonnable, partir 3 ans et demi engageait des frais très importants).
note 4 (M. Brut)
Marie Catherine ! L’éternelle oubliée ! Et pourtant, sûrement celle qui était la plus agréable (de caractère) de ses 3 enfants !
Mariée à Vincent Guichaneres d’Armajan, de petite noblesse, résidant dans une belle chartreuse à Preignac (près de Sauternes), actuellement château (viticole) d’Armajan des Ormes. Le beau-père, presque ruiné par la rénovation de son château vieux en chartreuse et Montesquieu se connaissaient. Vincent et Marie Catherine se sont épousés en 1738 dans la chapelle du château de La Brède (la seule de ses enfants) et avaient de l’inclination l’un pour l’autre, semble-t-il.
Jusqu’à 2010, les historiens, tels Louis Desgraves, recopiaient que Marie Catherine n’avait eu qu’un seul enfant, Charles ! En réalité, il a été retrouvé, à Preignac même, les actes de naissance de ses 7 enfants ! Aucune descendance après 1891.
note 5 (M. Colle)
Dans les Antiquités Bordelaises, 1797, page 387, Bernadau détaille l’incident : « Parcourant l’Europe pour composer son Esprit des Loix , Montesquieu avait coutume d’écrire sur les lieux toutes ses observations. Le gouvernement soupçonneux de Venise s’alarma des notes prises par l’illustre voyageur ; ses amis le lui apprirent. Il céda à leurs représentations et quitta cette ville secrètement. Comme il était sur mer, il vit des gondoles cingler vers la sienne ; croyant que le sénat envoyait du monde pour l’arrêter, il jetta à l’eau ses manuscrits qu’il pensait être l’objet des poursuites; mais point du tout, on passa sans le visiter. Sa douleur fut grande d’avoir perdu dans cette occasion des papiers de conséquence, qu’il avait écrit sur une ville qu’il abandonnait à regret. »
note 6 (M. Brut)
A l’époque de Montesquieu, le camérier avait la charge de Trésorier général du Vatican. Le titulaire était le cardinal Annibale Albani (charge de 1719 à 1747). Le nom Camérier fut remplacé par celui de camerlingue à partir du XVI eme siècle.
Actuellement, le Cardinal camerlingue à plutôt la lourde responsabilité de gérer le Vatican lors de la vacance de pape, jusqu’à la fin de l’élection.
note 7 (G. Lacoste)
L’origine de la daterie remonte au moins au XIV° siècle lorsqu’on distinguait la signature des lettres pontificales de l’apposition de la date qui était à la charge d’une personne spécifique, le dataire (datarius). A la fin du XV° siècle, il est à la tête d’un office pour préparer et dater la concession de certaines dispenses matrimoniales, la collation de bénéfices et l’octroi d’induits et de grâces. A partir du XVII° siècle, l’office est dirigé par un cardinal nommé le pro dataire.
note 8 (G. Lacoste)
in Louis Vian, Histoire de Montesquieu, 1878, p. 334-335, note 2 : « Extrait des registres des actes de décès de la paroisse Saint Sulpice pour l’année 1755. Le onze février 1755 a été fait le convoi et enterrement du haut et puissant seigneur Charles de Secondat, baron de Montesquieu et de La Brède, ancien président à mortier du parlement de Bordeaux, l’un des quarante de l’Académie française, décédé le jour d’hier, rue Saint-Dominique, âgé de soixante cinq ans, en présence de messire Joseph de Marans, ancien maître des requêtes honoraire, er de messire Joseph Guérin de Lamotte, maréchal de camp, gouverneur de Philippeville et cousin du défunt, qui ont signé : « Signé : Marans, Darmajan, Guérin de La Motte, comte Guyonnet de Guyonnet de Coulon, conte Marans, comte d’Estillac, et Rolland, curé ».
« Il (son corps) a disparu, sans que personne en ait pu retrouver la trace, même sous le Directoire, lorsque ses admirateurs le firent rechercher avec les renseignements de la famille en ligne directe qui existait encore : c’est sans doute qu’on l’a jeté dans les catacombes en 1793 ».
in Philippe Landru, « Les cimetières de France et d’ailleurs », 2010 :
»Les cimetières de Saint-Sulpice :
La paroisse de Saint-Sulpice qui, à la fin du XVIIIe siècle, était la plus étendue et la plus peuplée de Paris, eut une suite de six cimetières rattachés. Si tous les lieux qui suivent sont aujourd’hui en plein centre-ville, on n’oubliera pas qu’au XVIIIe siècle, ces lieux étaient semi ruraux pour l’essentiel.
….Le cinquième cimetière, dit de Bagneux
Il se trouvait à l’angle de la rue Vaugirard et de l’actuelle rue Jean Ferrandi, appelée jusqu’en 1935 rue de Bagneux (on ne saurait évidemment confondre ce petit cimetière avec l’immense et contemporain cimetière parisien de Bagneux). Son terrain rectangulaire mesurait 72m sur 28m. La fosse commune conservait les corps plus qu’elle ne les consommait (!). Faite pour contenir 500 cadavres, elle était fermée par une grille de fer tant qu’elle n’était pas comblée. Ce cimetière était clos par un mur, et contenait une petite chapelle de dévotion. La porte du cimetière était surmontée d’un sablier ailé et d’une inscription, transportée depuis aux catacombes, où on pouvait lire « Hodie mihi, cras tibi ». Ce cimetière ne servit que trente sept ans. Aujourd’hui loti, plus rien ne signale d’une quelconque manière son existence.
C’est peut-être dans ce lieu que fut inhumé l’un des plus grands esprits des Lumières, Charles de Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron de ). Les sources ne sont pas claires en ce qui concerne son lieu d’inhumation: soit il fut inhumé dans l’église Saint-Sulpice, soit il fut inhumé dans ce cimetière. »
note 8 bis (M. Brut)
Au sujet des personnes citées dans l’acte de décès /Montesquieu :
* Joseph de Marans : Ami de jeunesse de Montesquieu : ils étaient ensemble
au Collège de Juilly. Conseiller au Parlement de Bordeaux, il épousa une lointaine cousine de Montesquieu et devint ainsi son « cousin ». Sont toujours restés proches (voir la lettre émouvante que Marans envoie à l’Abbé Gadès, le 15 février 1755).
* Charles d’Armajan : le premier petit fils de Montesquieu, fils de Marie Catherine (voir note 4).
Alors âgé d’une quinzaine d’années, il résidait à Paris pour ses études lors du décès de son grand père, plus ou moins sous la » responsabilité » de ce dernier.
Il fut donc le seul de la famille proche à être présent le 10 février 1755….
Montesquieu était son Parrain. Célibataire et sans postérité, la date de son décès reste non trouvée à ce jour, mais il vivait encore après la Révolution.
Guerin de Lamotte : Présenté comme « … cousin du défunt…. » . Cette précision a été sans doute mal positionnée dans l’acte par celui qui le rédigea, le « cousin » étant Marans.
note 9 (M. Brut et M. Colle)
La plus grand partie de la rue Saint Dominique à Paris fut rasée par les travaux décidés par le baron Haussmann en 1877. Le percement du boulevard Saint Germain entraîna, entre autres, la destruction de la partie orientale de la rue Saint Dominique, à partir de la rue des Saint Pères.
note 10 (M. Colle)
Dans Le Viographe Bordelais, 1844, Pages 259-262, Bernadau rapporte en détail la façon dont Montesquieu a accepté en 1752 que Dassier frappe sa médaille.
« Ristcau fut honoré de l’amitié de Montesquieu; et c’est aux bons offices du négociant de Bordeaux que l’on doit la médaille du philosophe de La Brède, qui a été gravée par le fameux J.-A. Dassier. Voici comment M. Risteau raconte cette anecdote dans une lettre adressée au fils de Montesquieu, en 1778 : Je me trouvais à Paris en 1752, dit-il, en revenant de Bretagne; j’y fis un séjour fort court. Deux ou trois jours avant mon départ pour Bordeaux, je fus dîner chez mes banquiers MM. Duffour et Mallet. Ce dernier me voyant arriver, me dit : Je suis d’autant plus aise que vous soyez venu me demander la soupe aujourd’hui, que je vous ferai dîner avec un de nos anciens camarades de Genève. C’est notre ami Dassier, qui vient de Londres, et qui va faire un tour chez lui. Celui-ci arriva peu après. Nos premiers compliments faits, je lui adressai quelques questions sur le but de son voyage. Il m’avoua qu’étant occupé à faire une suite de médailles des grands hommes du siècle, et ayant appris que M. de Montesquieu était actuellement à Paris, il y était venu exprès, et qu’il souhaitait que quelqu’un put l’introduire auprès de lui, pour lui demander la permission de prendre son profil et de faire sa médaille. Alors M. Mallet l’interrompant, dit, que personne mieux que moi ne pouvait lui procurer cet avantage.Je lui répondis que, quoique j’eusse pris congé de M. de Montesquieu le matin même de ce jour, je me chargerais bien volontiers de la commission , sans oser me flatter de réussir; et après quelques instances de M. Dassier, je me déterminai à écrire sur une carte à M. de Montesquieu, pour lui faire connaître le désir qu’avait Dassier de le voir, et lui demander le moment qui lui serait le plus commode. J’envoyai cette carte par mon domestique, qui revint avec la réponse de M. de Montesquieu, écrite avec du crayon sur la même carie, en ces mots : Demain au matin, à huit heures. Le lendemain je me rendis avec Dassier chez M. de Montesquieu, rue Saint-Dominique. Nous le trouvâmes occupé à déjeuner avec une croûte de pain et de l’eau et du vin. Après toutes les politesses de part et d’autre, M. de Montesquieu demanda à Dassier s’il avait apporté avec lui quelques médailles. Sur quoi celui-ci lui en montra plusieurs. M. de Montesquieu s’écria en les examinant : Ah! voilà mon ami mylord Chesterfield, je le reconnais bien. Mais, M. Dassier, puisque vous êtes graveur de la monnaie de Londres , vous avez sans doute fait la médaille du roi d’Angleterre? — Oui, M. le Président; mais comme ce n’est qu’une médaille de roi , je n’ai pas voulu m’en charger. — A votre santé, pour ce bon mot, M. Dassier, dit M. de Montesquieu, qui tenait alors un verre plein.
La conversation s’anima et devint alors d’autant plus intéressante, que Dassier avait beaucoup d’esprit. Aussi au bout d’un quart d’heure, il fit venir très adroitement la demande qu’il se détermina enfin à faire à M. de Montesquieu, de prendre son profil et de faire sa médaille. Il fit surtout beaucoup valoir qu’il avait fait le voyage de Londres à Paris tout exprès, dans l’espoir qu’il ne lui refuserait pas cette grâce. Après un moment de réflexion de la part de M. de Montesquieu, qui occasionna une espèce de silence, il prit un ton sérieux et lui dit : M. Dassier, je n’ai jamais voulu laisser faire mon portrait à personne. Latour et plusieurs autres peintres célèbres, qu’il nomma, m’ont persécuté pour cela pendant longtemps. Mais ce que je n’ai pas fait pour eux, je le ferai pour vous. Je sais, dit-il en souriant, qu’on ne résiste pas au burin de Dassier, et même qu’il y aurait plus d’orgueil à refuser votre proposition qu’il n’y en a à l’accepter. Dassicr remercia M. de Montesquieu avec des transports de joie qu’il modérait avec beaucoup de peine. Il lui demanda enfin son jour. Tout à l’heure, lui répondit M. de Montesquieu, car je compte aller demain ou après-demain à Pont-Chartrain voir M. de Maurepas, où je passerai quelque temps, et je ne pourrai disposer que de ce moment; je vous conseille d’en profiter. Sur quoi Dassier tira ses crayons de sa poche, et j’assistai une demi-heure à son travail. Il en était à l’œil lorsque je pris congé; et alors se tournant vers moi : Ah ! me dit-il, mon ami, le bel œil ! qu’il fera un magnifique effet !
Je partis le lendemain pour Bordeaux, et je ne vis plus Dassier, qui, lorsque la médaille fut frappée, m’en envoya six en présent. Je n’en voulus accepter qu’une, et lui tins compte des cinq autres que je distribuai à son profit. M. de Montesquieu me dit l’année suivante à Bordeaux, qu’à son retour de chez M. de Maurepas il avait encore donné plusieurs séances à Dassier et qu’il avait été fort long ‘.
Voilà au vrai ce qui s’est passé dans cette occasion : il n’y a point eu d’autre témoin que moi. »
1 Quoique Dassier dessinât avec beaucoup de rapidité. Montesquieu le trouva fort long, parce que lui-même était fort vif et qu’il était difficile de saisir sa ressemblance, attendu la grande mobilité de ses traits. Le peintre italien qui fit à Bordeaux, pour l’abbé de Guasco, le portrait de Montesquieu, qu’on a gravé a Florence, en 1767, assurait n’avoir jamais peint un homme dont la physionomie changeât tant d’un moment à l’autre, et qui eût si peu de patience à prêter son visage.
note 11 (Bernard Girel)
On sait que Montesquieu a été très largement édité « A Amsterdam et Leipsick chez Arkstée et Merkus » avec l’approbation du Stadhouder des Provinces Unies, le prince guillaume V d’Orange (ainsi l’édition très intéressante des LOIX de 1759, avec ses deux cartes rempliées, qui comprend à la demande des éditeurs les « Remarques d’un anonyme », très conséquentes et pas toujours très amènes sur l’auteur ou les » lettres familières » dans l’édition de 1775. C’était fréquent pour qui ne pouvait ou ne voulait subir la « censure » de l’approbation et du privilège royal (notamment les auteurs encore inconnus ou subversifs comme Rousseau ou Voltaire plus tard mais déjà Montaigne à Londres ou Genève). Par la suite il sera réédité un peu partout mais surtout chez la Famille Renouard à Paris ou Causse à Dijon (ainsi les Considérations sur…) ou encore chez Gueffier ou Langlois, tous deux à Paris…Et d’autres…
note 12 (G. Lacoste)
Le nom est illisible; il peut s’agir de Brunet Jean Charles qui a écrit en 1810 un Manuel de l’amateur de livres, ou plus vraisemblablement de Barbier Antoine Alexandre, auteur en 1808 d’un Dictionnaire des Ouvrages anonymes et des pseudonymes.
note 13 (M. Brut)
À l’époque de Bernadau, on ne connaît que celles publiées par l’Abbé comte Guasco (1767 – plus ou moins 67 lettres selon l’édition) et » les 9 lettres nouvelles » que signale Bernadau.
Dans l’intégrale des Œuvres de Montesquieu, éditée sous la responsabilité de Catherine Volplihac Auger, il y aura 3 tomes de Correspondances, soit environ 550 lettres !!!!! ( 2 tomes parus à ce jour). Dans l’Edition initiale de 1914, en 2 tomes, il y en avait près de 460.
note 14 (M. Brut)
Le texte exact, dans la lettre de Montesquieu à Helvetius du 11 février1749 dit : » … je devins fol du Rhadamiste », pièce de théâtre de Crébillon Père que Montesquieu portait aux nues et à la représentation de laquelle il a assisté en 1711, à 22 ans, pendant ses » belles et vertes années ».
note 15 (G. Lacoste)
François Risteau, négociant à Bordeaux, mort dans cette ville en 1784 à l’âge de 70 ans devint directeur de la compagnie des Indes et employé par le gouvernement dans la négociation faite à Londres en 1771. Ami intime de Montesquieu, il défendit avec énergie et une logique puissante l’ouvrage de ce dernier dans un écrit ayant pour titre : « Réponse aux observations sur l’Esprit des lois », 1751 in12.
Selon Bernadau (in Histoire de Bordeaux) «Montesquieu disait qu’il aurait été fort embarrassé de certaines objections que Risteau avait réfutées complètement ».
note 16 (G. Lacoste)
François de Labat, chevalier de Vivens (1697-1780), économiste français, gentilhomme agençais, ami de Montesquieu, qui possédait à Clairac une propriété voisine de la sienne et qui, comme lui, cultivait la vigne, a publié « Observations sur divers moyens pour soutenir et encourager l’agriculture principalement celle de la Guyenne », 1756.
note 17 (M. Colle)
Louis-Mayeul Chaudon (1737-1817) est surtout connu pour son Nouveau Dictionnaire historique paru en 1766, dont le succès surpassa toutes ses espérances. Il fut en effet imité ou traduit dans plusieurs langues et tout concourut à prouver sa supériorité sur ceux qui avaient paru jusqu’alors dans le même genre.
En 1767, il publia le Dictionnaire antiphilosophique, dans lequel, tout en rendant justice aux talents d’écrivain de Voltaire, il repoussait avec force ses attaques contre la religion. La Révolution le ruina presque et il fut donc dans la nécessité de chercher, à un âge avancé, des ressources dans la vente de son Dictionnaire, dont il fit huit éditions. Il a aussi fait des publications dans le Bulletin polymatique du Musée de Bordeaux. Chaudon était très apprécié de ses concitoyens de Mézin, et cela devait être un homme particulièrement aimable pour pouvoir s’honorer de l’amitié de Bernadau.
C’est un peu plus tard, en juin 1817, qu’il nous annoncera la disparition de celui qui sera resté son ami depuis 1797, ce qui semble l’étonner lui-même : « Je dois observer ici que, depuis une vingtaine d’années, je suis lié par correspondance avec M. Chaudon, qui a eu la bonté de m’envoyer ses ouvrages », et un peu plus loin, il va jusqu’à parler de « correspondance suivie et très affectueuse » !
note 18 (M. Brut)
Montesquieu ne risque pas dormir » dans le château de Montesquieu », baronnie village de Montesquieu près d’Agen : du temps de son père, le dit château était déjà en état de délabrement ! Il n’y a pas célébré le mariage de Denise en 1745, pour cause d’incommodités.
note 19 (M. Colle)
Renseignements pris auprès de Mme Edith Ouy, guide du château de la Brède, cette plaque n’est plus en place sur la porte du château.
Ces vers sont aussi cités :
– avant 1823 par Victor-Joseph Etienne, dit M. de Jouy, « Les Hommes d’autrefois et les choses d’à présent », L’Hermite en province ou Observations sur les mœurs et les usages français au commencement du XIX° siècle, tome I, n°3, 8 février 1817, Paris, Pillet Aîné, 1819, p. 27-30.
après 1823 dans « Département de la Gironde », Guide pittoresque du voyageur en France, tome I, n°18, Paris, Firmin Didot Frères, 1838, p. 14. ainsi que dans la Notice sur le Château de La Brède (1839) de Charles Grouet.
note 20 (G. Lacoste et M. Colle)
Jean-Eléazar L’Hospital, né en 1754 et mort en 1819 à Bordeaux, fut avocat au Parlement de Bordeaux, littérateur et poète. Il a notamment écrit une Apologie de Voltaire et un Eloge de Tourny ainsi que quelques brochures au moment de la Révolution à Bordeaux. Il est l’auteur d’une Lettre sur le Tableau de Bordeaux (1810, Foulquier, in-8°de 106 pages), violente réfutation de la brochure de Bernadau intitulée Lettre sur le Tableau de Bordeaux, dans laquelle il lui reproche « les emprunts, les plagiats ou les vols que l’auteur s’est intrépidement permis à {son} égard ». Grand spécialiste des notices nécrologiques aimables, Bernadau en rédigera une à l’occasion de la disparition, en 1819, de son collègue qui ne pourra plus lui répondre : « C’était une espèce de fou, qui écrivait sur tout, sans rien savoir ni apprendre … Il m’avait voué une haine violente parce que je n’avais pas voulu faire mention de lui dans aucun de mes ouvrages historiques, ne croyant pas qu’il méritât d’être signalé aux regards publics, tant il était ridicule comme littérateur. »
Sur Pierre Bernadau, voir le site : Bernadau.wordpress.com