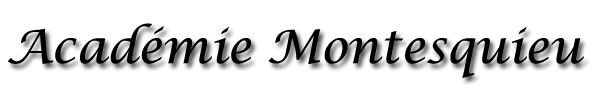Dans l’Antiquité et jusqu’au Moyen Âge, les femmes ont été des soignantes, à l’image de cette sainte Irène de Rome prodiguant des soins attentionnés à saint Sébastien en retirant les flèches reçues pendant son martyr pour avoir professé le christianisme. De nombreuses sources attestent que les Gallo-Romaines pratiquèrent la médecine, comme, en Aquitaine, Aemilia Hilaria, qui exerça à Bordeaux avec son beau-frère, Iulius Ausonius, un médecin originaire de Bazas. Son neveu, le poète Ausone qu’elle chérissait comme un ls, rendit hommage dans Parentalia à cette femme qui « pareille à un homme s’adonna à l’art du médecin ».
Alors qu’elles étaient nombreuses à pratiquer cette discipline, le Moyen Âge, et plus précisément l’année 1322, a vu, au terme d’un procès retentissant, disparaître les femmes médecins en France sous l’effet d’une interdiction qui durera jusqu’à la fin du XIXe siècle. Mais que s’était-il passé pour en arriver là ?
Au XIIIe siècle, quand les universités se développèrent, un enseignement gratuit et régulier fut dispensé pour les jeunes hommes bourgeois (c’est-à-dire à l’époque les habitants des bourgs), dans des matières aussi variées que la philosophie, la théologie, l’astronomie, le droit ou encore la médecine. Peu à peu, l’enseignement de la médecine par le biais des universités s’imposa comme la seule formation valable. Une décision allait se révéler déterminante quand, en 1271, l’Université de Paris publia un statut interdisant la prescription de remèdes – et donc l’exercice de la médecine – à ceux qui n’auraient pas reçu de doctorat. L’université était réservée aux hommes, excluant de facto les femmes du métier, et ce quelle que soit leur formation extérieure, désormais non reconnue. Certaines poursuivirent cependant leurs pratiques, ce qui conduisit, en 1322, au procès de l’un des médecins les plus renommés de la capitale, Jacqueline Félicie de Almania, qui se vit interdire l’exercice de la médecine sous peine d’être excommuniée. Cette décision eut un impact énorme au sein des milieux médicaux et, faisant jurisprudence, elle eut pour conséquence d’exclure les femmes de l’art médical pendant de nombreux siècles, ces dernières se cantonnant à des emplois d’infirmières ou de sages-femmes.
Aujourd’hui, à Bordeaux comme partout en France, près d’un médecin sur deux est une femme. Les lles représentent près de 70 % des inscrits en première année commune aux études de santé, et encore 60 % des étudiants en deuxième année de médecine. Bien sûr, il n’en a pas toujours été ainsi et la réappropriation par les femmes du métier médical fut un long chemin : à la fin du XIXe siècle, elles n’étaient encore que quelques dizaines en France et elles se comptaient sur les doigts d’une main à Bordeaux. Et si l’accès des femmes au diplôme de docteur en médecine ne s’est pas fait sans difficultés, le droit pour elles de postuler aux concours hospitaliers leur fut encore plus longtemps contesté.
Des Bordelaises ont-elles ouvert la voie ? Sans doute, mais dans la discrétion, conduisant à l’oubli. Il fallait les retrouver, ces courageuses pionnières.
C’est d’abord un article très documenté d’Haryett Fontanges, paru en 19011, qui indique que Bordeaux compte alors deux femmes installées docteurs en médecine, Mlle Mesnard au 24 bis rue du Temple et Mlle Belly. Ce sont ensuite les Guides Rosenwald qui, en recensant depuis 1887 l’ensemble des médecins de France, nous confirment que la première a passé sa thèse de doctorat en 1884 et la seconde « seulement » en 1897. Poursuivant cette enquête, il apparaît que la thèse de Mlle Mesnard a été soutenue à Paris ; si elle est bien la première femme installée docteur à Bordeaux, elle n’est pas pour autant la première diplômée docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux, distinction qui revient à Mlle Belly ! D’autres leur ont emboîté le pas : Mmes Pédespan-Lamugue et Déga-Lussagnet en 1898, Mlle Chartrou en 1899, année où une première interne des hôpitaux de Bordeaux est nommée, Mlle Nourrit, suivie cinq années plus tard par Mlle Campana. Nous avons tenté de retrouver les traces de ces sept femmes qui ont ouvert la voie et qui méritent de ne pas être oubliées.
Paris avait devancé la capitale girondine, et de plusieurs années, puisque Madeleine Brès avait obtenu sa thèse en 1875 dans cette Faculté et que Augusta Klumpke avait été reçue à l’Internat des hôpitaux de Paris en 1886. Et déjà pointe une particularité pour cette dernière, son origine américaine. Car des étrangères avaient précédé les Françaises, non seulement dans d’autres pays (Elizabeth Blackwell aux États-Unis en 1849 et Frances Morgan à Zurich en 1870), mais aussi en France où deux Anglaises avaient présenté leurs thèses à Paris en 1870 (Elizabeth Garrett) et en 1871 (Mary Putnam).
L’arrivée de ces premières étudiantes, particulièrement les étrangères, à la Faculté de médecine de Paris dans la décennie 1870, entraîna l’hostilité de la communauté médicale, y compris chez des personnalités respectées de l’Université. Bien heureusement, d’autres s’engagèrent courageusement aux côtés de ces jeunes femmes qui prétendaient devenir docteurs en médecine et envisageaient même de concourir pour les carrières hospitalières !
Le tournant du siècle passé, seuls les anti-féministes les plus acharnés continuèrent le combat. Avec le temps, vint l’apaisement et, progressivement, l’opinion publique fut dé nitivement conquise, même si quelques bastions furent plus longs à tomber.
Cependant, évoquer, aux confins des XIXe et XXe siècles, les premières femmes docteurs à Bordeaux n’est-il pas déjà faire preuve d’anti-féminisme ? Imaginerait-on consacrer un ouvrage au premier juif ou au premier musulman, au premier noir ou au premier Asiatique, voire au premier Charentais ou au premier Landais qui ait décroché le diplôme de la Faculté de médecine de Bordeaux ?